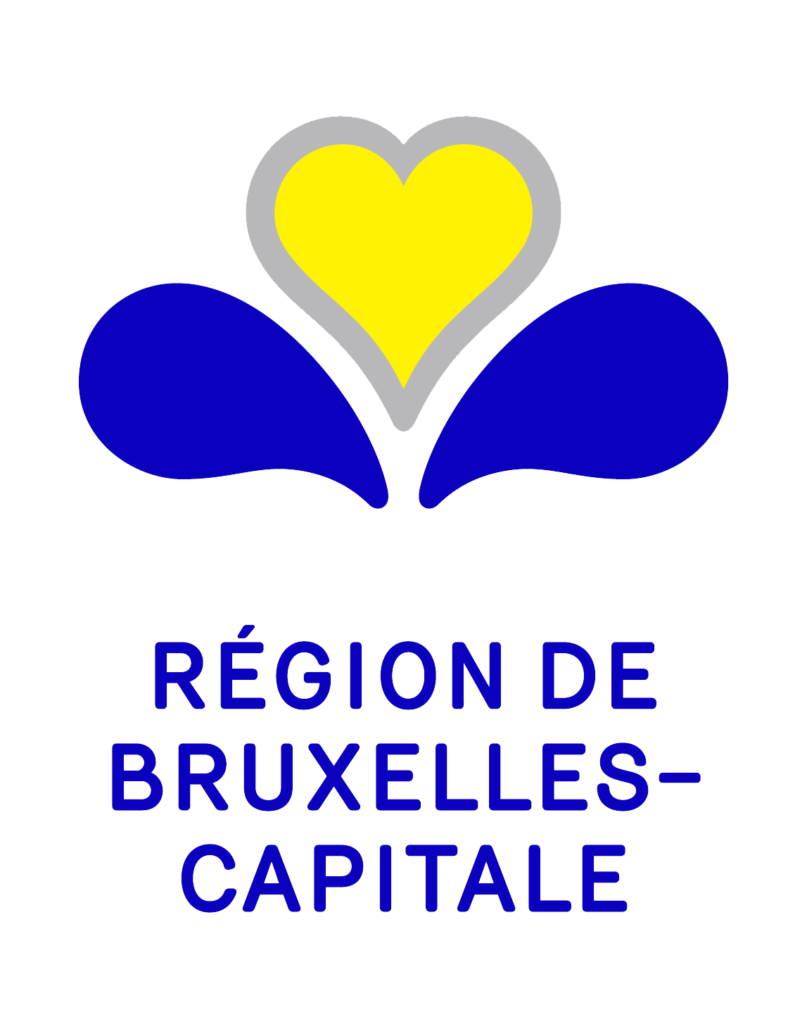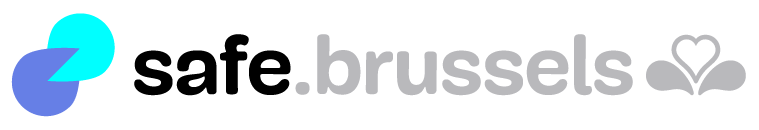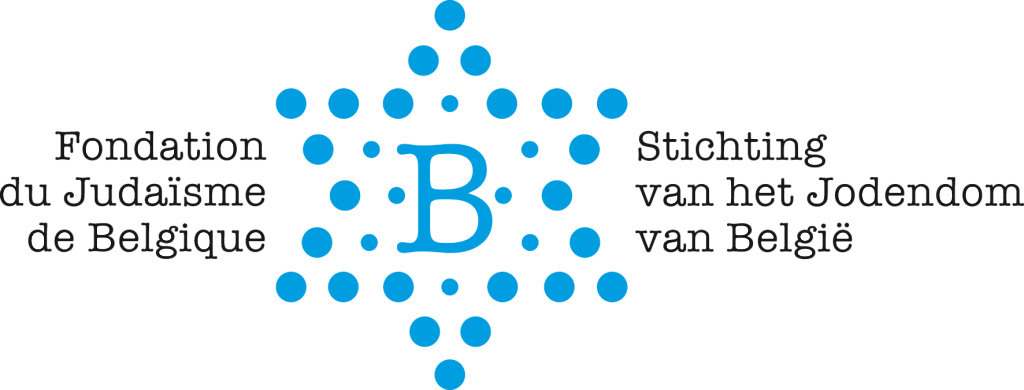Mais à qui la faute, sinon à cette malheureuse Flandre, plus que jamais piégée par la légende noire d’une Flandre largement acquise aux Allemands, mais pour de bonnes raisons (autodétermination flamande), face à une Wallonie belgicaine, résistante et vengeresse. Tout cela serait anodin si cette légende noire, érigée en code culturel, ne générait logiquement un sentiment ambigu et profondément, malsain à l’égard des Juifs.
On a beau justifier a posteriori la collaboration avec l’occupant, les crimes commis envers les Juifs, notamment avec l’appui de la police d’Anvers, n’en restent pas moins en travers de la gorge de la-Noble-Cause-nationaliste, d’où précisément ces transgressions qui constituent autant de stratégies d’évitement. Car à bien y regarder, l’idée première est bien de relativiser à tout prix la Shoah et ce, tantôt en péjorant l’image des Juifs (et/ou sionistes), tantôt en améliorant celle des collaborateurs. Le carnaval d’Alost en est la parfaite illustration avec des représentations comiques des bourreaux (des SS hilares distribuant aux badauds du Zyklon B) et péjoratives des Juifs, tantôt suceurs d’or, tantôt terreur des Palestiniens.
C’est encore et toujours cette impérieuse volonté de couvrir les errements (réels ou supposés) de leurs aïeux qui explique la formidable haine que portent nombre d’intellectuels et artistes flamands à l’égard de l’Etat juif : ainsi de ce caricaturiste qui assimile la Palestine à Auschwitz, de ce syndicaliste qui en vient à accuser les soldats israéliens de trafiquer les organes d’enfants palestiniens, de ce professeur d’histoire qui propose de démanteler le Musée de la Shoah de Malines, de ces centaines d’autres qui militent pour BDS, etc.
La remise le 18 mars 2020 par la Vrije Universiteit Brussels (VUB), associée à l’ULB, d’un diplôme conjoint de Docteur Honoris Causa à Simon Gronowski et Koenraad Tinel participe aussi de cet enfumage mémoriel, car ces deux gaillards ne manqueront pas d’être présentés, sinon perçus, comme deux victimes de la Seconde Guerre mondiale, le premier de la Shoah, le second de la… répression à l’égard des inciviques.
Car c’est bien de cela qu’il s’agit, comme le donne à croire l’historien de la culture David Van Reybroeck, qui les présente comme deux frères quasi siamois. Je le cite : « Abstraction faite de ce qui les séparait, ils se sont découvert bien des points communs : tous deux ont été chez les scouts, tous deux ont appris à jouer du piano et tous deux ont souffert d’énurésie nocturne ». Certes, sauf qu’au-delà de leurs communes pertes urinaires, l’un a perdu sa mère, son père et sa sœur et l’autre pas le moindre membre de sa famille, sinon la jambe d’un grand frère amputée tandis qu’il défendait, en avril 1945, le bunker d’Hitler. Sauf encore qu’au-delà de leur commun amour de la belle musique, l’un a subi les pires privations durant la guerre, tandis que l’autre l’a très bien vécue, jusqu’à la chute finale, il est vrai.
D’aucuns pourraient me reprocher de faire porter à Koenraad les fautes et crimes de son nazi de père et de ses deux SS de frères ; son second frère fut, en effet, gardien dans le camp de transit de Malines, l’antichambre de la mort pour les Juifs de Belgique. Certes, sauf que notre homme s’est toujours refusé à condamner sa famille, comme le souligna, bien candidement, le poète Filip Roegiers dans le quotidien flamand Standaard : « Le premier a appris du second qu’il n’avait pas à porter le poids de la culpabilité de son père. Qu’il n’était plus nécessaire de renier ses origines. Ni de haïr son père. Le second a appris du premier qu’il n’était pas nécessaire de demeurer l’éternelle victime pour honorer ses proches perdus ».
Si l’on peut comprendre qu’un fils puisse refuser de condamner son père, on acceptera moins qu’il se posât en victime de guerre, comme en témoigne le récit autobiographique relatif à la fuite des Tinel vers l’Allemagne, puis à leur brève incarcération. De quoi ce récit, savamment intitulé le Seau à merde (« scheisseimer »), est-il le nom ? Sinon précisément de la volonté de Koenraad Tinel de solder la Collaboration. Son récit, tout en noirceur, n’a d’autre objectif que de susciter de la pitié pour les « victimes » de la répression « antiflamande ». Est-ce vraiment par hasard si dans sa description de la fuite précipitée des Tinel vers le réduit nazi, notre Koenraad use et abuse des mots de la Shoah. Le « seau à merde », thème récurrent des récits concentrationnaires, n’est plus celui des Juifs d’Auschwitz, mais des « déportés » flamands. Oubliant de préciser que la « déportation » fut, ici, volontaire, son récit associe immanquablement le malheur flamingant à la catastrophe juive.
Quelle leçon politique, autre qu’une amnistie déguisée, pourra-t-on tirer d’une cérémonie académique qui mettra sur un pied d’égalité un enfant de la Shoah et de la Collaboration ? Réduire la Seconde Guerre mondiale à une zone grise (Van Reybroeck), sans bourreaux ni victimes, est tout à la fois pervers et dangereux. S’il fallait s’interdire de porter le moindre jugement sur la Collaboration, l’enseignement de la Seconde Guerre mondiale n’aurait assurément plus aucun sens. Poser Koenraad Tinel en victime de la guerre, au même titre que Simon Gronowski, revient à interdire toute tentative de réflexion sur la responsabilité morale et politique des citoyens confrontés à la barbarie.