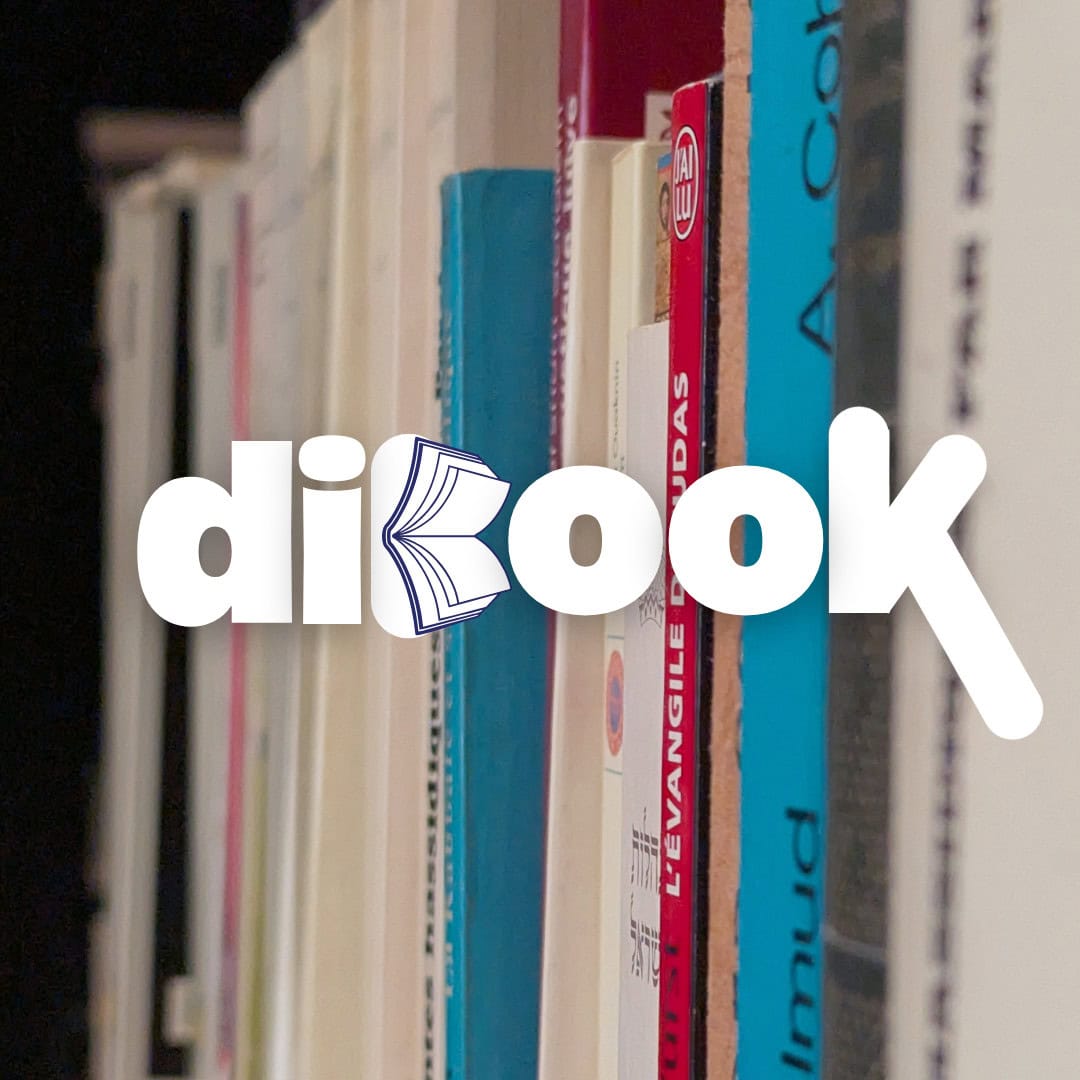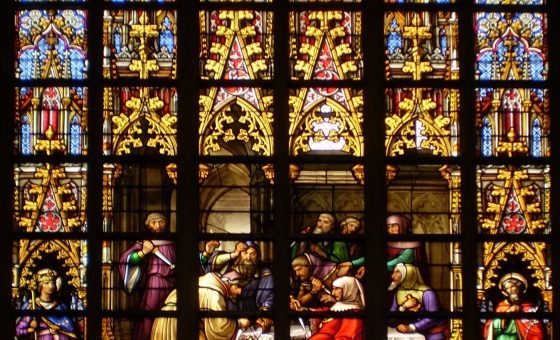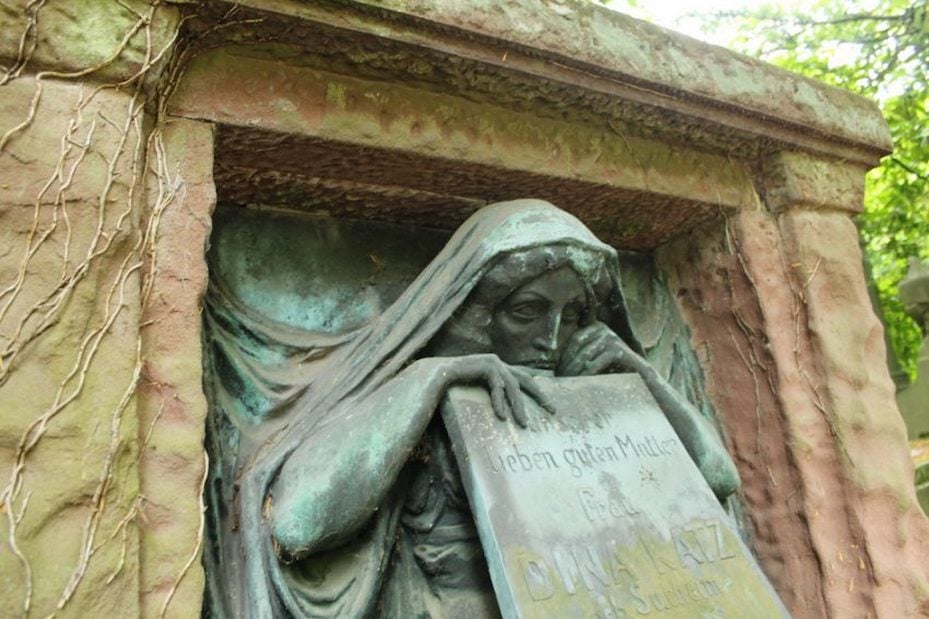Fin janvier, à Bruxelles, lors d’une séance organisée par l’Institut de la Mémoire Audiovisuelle Juive (IMAJ), Thom Vander Beken présentait The Last Jewish Summer, un documentaire singulier sur la Shoah à Anvers, inauguré au festival international du film de Gand.
Titulaire de masters en littérature néerlandaise et anglaise (UGent) et en mise en scène (LUCA), documentariste et réalisateur en réalité virtuelle, dans Sur les traces de Martin (Martin’s Journey, 2013), Vander Beken suivait le voyage de la famille Wolff en Allemagne et en Pologne, à la recherche du passé de leur père qui, après avoir survécu à Auschwitz-Birkenau et Dora, s’établit à Gand et fonda une famille de sept enfants, occultant très longtemps sa mémoire de la Shoah.
La collaboration de la police anversoise à la persécution des Juifs est évoquée dans Wil (2023) de Tim Mielants, adaptation du roman éponyme de Jeroen Olyslaegers (publié en 2016 et traduit en français: Trouble (2019)), dans lequel un vieillard, Wilfried Wils, relate son trouble passé de policier pendant l’Occupation. Le film plonge dans l’horreur en 41-42, montre la terreur exercée par l’occupant et ses collaborateurs locaux, la participation de la police anversoise à la persécution des Juifs, et l’action des résistants de la Witte Brigade que rejoint Wil, lié malgré lui à la collaboration. Le déchaînement de violences, tout au long du film, figure les situations extrêmes vécues par le jeune policier et ses collègues, forcés à faire des choix terrifiants…
Un film sur le silence des survivants
The Last Jewish Summer, aborde ce même chapitre de l’histoire sous une approche documentaire, avec de vrais témoins. Le projet démarre lorsqu’un ami de Thom lui offre le livre « 1942, l’année du silence », et l’incite à en faire un film : 1942. Het jaar van de stilte (2019) de Herman Van Goethem décrit la participation active de la police et de l’administration anversoises à la Shoah. Comme l’avait révélé Lieven Saerens, dans “Vreemdelingen in een wereldstad: een geschiedenis van Antwerpen en zijn joodse bevolking (1880-1944). Tielt, Lannoo, 2000.”, le bourgmestre Delwaide et le commissaire principal De Potter facilitent l’arrestation et la déportation des Juifs anversois. La police locale joue un rôle actif dans les rafles de l’été 42 que Van Goethem retrace pas à pas. Des policiers tentent d’aider les Juifs ou refusent de participer aux rafles. La plupart obéissent aux ordres. La majorité de la population anversoise reste passive. Comme le souligne Thom, « Le dernier été juif » est un film sur le silence, le long silence des survivants de la Shoah et surtout celui des enfants de tous les Anversois qui ont collaboré avec les Allemands, ou se sont tus face aux horreurs de l’été 1942 : « J’ai passé beaucoup de temps dans les archives, rencontré les historiens spécialistes de la Shoah et cherché des témoins. D’une façon typiquement flamande, quelqu’un me donne le nom de quelqu’un à interviewer et j’appelle cette personne qui me dit : « Non, mon père n’était pas du tout un collabo ! » 80 ans après la fin de la guerre, beaucoup ont du mal à reconnaître notre responsabilité collective dans ces événements ! J’ai multiplié les rencontres avec les descendants de victimes, dont beaucoup ont longtemps ignoré ce qu’avaient vécu leurs parents en 1942. Aujourd’hui, la plupart des survivants ont disparu, mais leurs enfants et petits-enfants luttent encore avec les traumatismes du passé. Le film porte donc aussi sur la transmission intergénérationnelle du traumatisme. »
Thom a voulu impliquer dans son film des élèves de l’Athénée royal d’Anvers : « Avant la guerre, de nombreux Juifs fréquentaient cette école devenue aujourd’hui un espace multiculturel où se croisent plus de cent nationalités, mais pas un seul Juif ! En collaboration avec les professeurs d’histoire, le projet de film s’est adressé aux élèves de rhéto dans un long processus de préparation les incitant à y participer. Cinq jeunes filles se sont portées volontaires : Negina, Shehinaz, Amelia, Julie et Zita. Nous avons organisé des séances de discussions, lu des textes, regardé des archives… Lorsqu’elles ont rencontré les quatre membres de familles juives victimes des déportations en 1942 qui témoignent dans le film, elles ont compris l’importance de leur participation au projet, compris que la Shoah n’est pas qu’une page de manuel d’histoire, mais qu’elle a frappé leur ville et leur école. La famille de Yaël Reicher, originaire de Pologne, immigre à Anvers et prospère dans l’industrie du diamant. Son père a étudié à l’Athénée d’Anvers. L’oncle de Melvyn Fishel est l’un des vingt garçons juifs renvoyés de l’école en janvier 1942. Herman Jeger a 9 ans lorsqu’il assiste à l’arrestation de sa mère : elle n’est jamais revenue. Peggy Poppe a 16 ans lorsqu’elle découvre que sa famille est juive : sa grand-mère, Charlotte Hamburger, membre de la résistance en 1942 est arrêtée, déportée et assassinée à Auschwitz. Peggy est devenue psychothérapeute ! » Les élèves ont rencontré aussi les trois descendants d’Anversois impliqués dans la traque aux Juifs qui témoignent dans le film : « Le grand-père de Ben Michiels, policier, a participé aux rafles de 1942. Les grands-pères de Francis Weyns[1] étaient tous deux des collaborateurs. Hendrik Wiethase a récemment découvert que son père, soldat de la SS, était un chasseur de Juifs à Anvers. Témoins comme élèves, tous sont conscients de l’importance de raconter cette histoire. »
Dispositif documentaire innovant
Face au manque de documents visuels sur les déportations de l’été 1942, le cinéaste choisit la reconstitution historique et persuade les « protagonistes » du film de témoigner devant la caméra, dans un décor des années 1940, construit en studio, en jouant le rôle du parent disparu dont ils relatent l’histoire, faisant ainsi l’expérience physique du récit, vêtus selon l’époque, comme Ben qui rejoue l’histoire de son grand-père avec l’uniforme du policier anversois en 1942. Les cinq jeunes accompagnent les témoins dans leur reconstitution, déplacent les meubles et accessoires du décor devant la caméra… Elles énoncent aussi l’Histoire, produisant devant la caméra les documents d’archives et commentant les récits familiaux que « rejouent » les témoins. Entrecoupant les propos de ces douze « acteurs », des plans du film montrent les décors juxtaposés, l’installation de l’éclairage, le matériel de tournage, le clap, le témoin qui se prépare à raconter la scène suivante… Ce dispositif innovant donne au documentaire une forme de métacinéma, autoréférentiel. Thom conclut : « Chaque histoire est une construction. Ce film n’est pas la version finale de l’histoire des déportations de 1942. Nous avons travaillé pendant quatre ans, construisant un récit cohérent, où tout s’imbrique parfaitement, préparant les témoins et les élèves à partager leurs histoires et leurs émotions dans un ‘‘décor de théâtre’’. Tout a été préparé minutieusement pour ne pas perdre de temps sur le plateau. Le tournage s’est fait en neuf jours dans ce studio, construit dans un entrepôt du port d’Anvers. Le montage a duré de septembre 2023 à avril 2024. La diffusion du film est prévue à la télévision : cet automne sur Canvas puis à la RTBF. »
__________________________________________________________________________________
[1] Francis Weyns relate leur histoire dans De schaduwjaren. Het verhaal van mijn twee grootvaders in de oorlog, zwart en helemaal fout (2019). Gaston Delbeke, criminel de guerre, est fusillé en 1948.