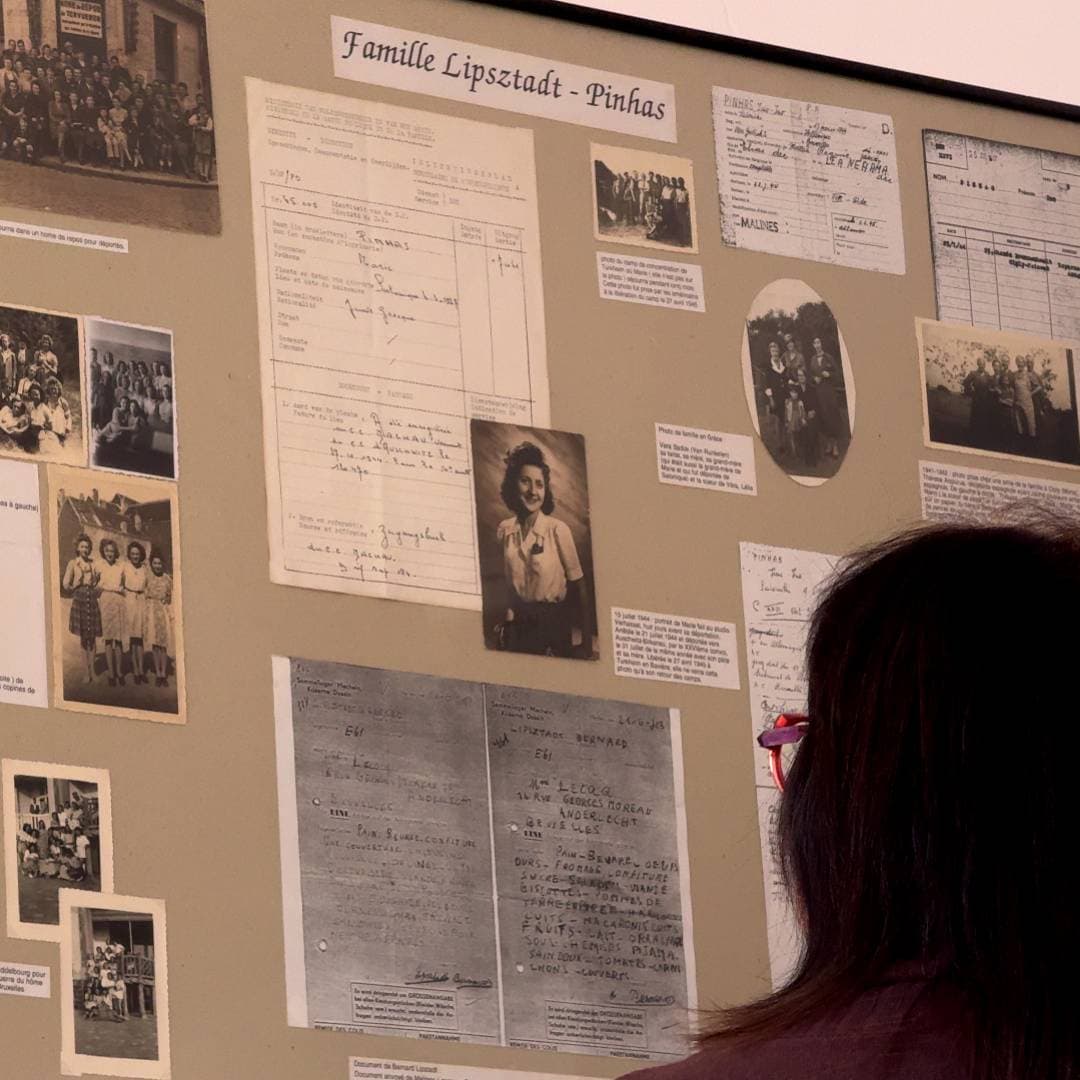Elevé au rang de film culte, le long-métrage des frères Coen fête ce printemps son vingt-cinquième anniversaire. En toile de fond, d’hilarantes références ashkénazes et une étrange passion judéo-centrée pour le bowling.
De Barton Fink à No Country For Old Men, de A Serious Man à Fargo, le cinéma des frères Coen ne ressemble à aucun autre. En exposant de manière cynique et loufoque les marottes de la société américaine, celui-ci a rapidement conquis la critique. A ce jour multirécompensé, il constitue un art dense, une mise en récit géniale et toujours à la marge. Au fil des années, les critiques se sont échinés à comprendre ce que Joel et Ethan Coen faisaient différemment. Si techniquement leur image est réputée comme étant inventive et soignée, leur patte provient sans doute du supplément d’âme apporté par des personnages toujours attachants. Le tout, évidemment réhaussé d’un regard juif sur le monde, ceci même lorsque leurs personnages sont éloignés de la tradition. De cette méthode baptisée « coennerie » par certains critiques malicieux, The Big Lebowski, dont on célèbre justement les 25 ans ce printemps, témoigne largement.
Pareil à la trame d’un roman de Philip Roth écrit sous un épais nuage de cannabis, le film met en scène une ribambelle de personnages cosmopolites perdue dans un monde à la dérive. Riches et pauvres, blancs et noirs, yids et latinos se retrouvent tous dans le même bateau (à la dérive). Avec, toujours, cette préférence savoureuse pour les losers, les benêts, tous ces anti-héros sans véritable destinée grandiose, ballottés par l’existence. Le résultat est là, loin d’être anecdotique : « En presque trente ans de carrière », explique le critique Serge Kaganski qui leur consacrait une rétrospective à la Cinémathèque, « les frères Coen ont intégré la short list enviable des cinéastes américains les plus aimés et attendus dans le monde. Contemporains de David Lynch, Jim Jarmusch, Michael Mann, Tim Burton, David Fincher, Quentin Tarantino ou de leur ami de jeunesse Sam Raimi, ils ont à peu près le même statut de super auteurs internationaux oscillant entre l’indépendance financière, la singularité esthétique, les concessions ponctuelles aux grands studios et le succès, un pied dans le système hollywoodien, l’autre en dehors ».
Si Kafka avait fait de la comédie
Dans cette filmographie dense, une œuvre tire donc son épingle du jeu et fait office d’objet cinématographique non identifié : The Big Lebowski ou l’histoire un brin tirée par les cheveux du Dude, personnage mythique, aussi cool que fainéant. Ce type sympathique et apathique, le hasard va (évidemment) le malmener. Sans qu’il ne demande rien à personne, un malfrat le confondant avec son homonyme milliardaire, Jeffrey Lebowski, entre chez lui et se permet d’uriner sur son tapis persan, celui « qui harmonisait si bien la pièce ». Débute alors une quête rocambolesque, sans queue ni tête, à travers Los Angeles. Le tout sur fond de rock des années 1970, de compétitions de bowling et d’amitiés incongrues entre antihéros se rejoignant dans leur propension à ne pas monter à bord du train du capitalisme triomphant. Lebowski, on l’aura compris, est un loser. Mais un loser conçu d’après un certain modèle, que l’on dirait parfois proche des personnages d’Isaac Bashevis Singer. Armé de son flegme à toute épreuve et de sa petitesse, le Dude avance bon an mal an à mesure que l’intrigue se corse, se brouille et se perd. « Ces failles morales, ces impasses scénaristiques ne sont pas réservées aux personnages dont le spectateur pourrait dire “quel loser ! Heureusement que je suis plus malin que ça”, reprend Kaganski. « Non, ce que subissent les protagonistes des Coen, nous le traversons tous à un moment ou un autre de nos vies et nul doute que les deux frères s’y reconnaissent aussi et s’y projettent. Loin de surplomber cyniquement leurs créatures, les Coen les accompagnent : elles incarnent sinon la lettre de leur vécu, du moins leurs peurs, leur inquiétude ». Et le critique de confirmer : « L’ethos profond du cinéma des frères Coen est à chercher du côté de Kafka : une humilité lucide et inquiète face au chaos indéchiffrable de l’existence dont il faut aussi savoir sourire pour conjurer le désespoir ». Il y a là, bien évidemment des tsures (des emmerdes) mais pas seulement…
Si The Big Lebowski est devenu mythique c’est bien dans sa propension à faire rire son spectateur. En la matière, le comique provient largement de Walter Sobchak personnage secondaire et ami de Lebowski. Un énergumène qui traverse le film en bermuda, affichant un profil peu commun. Impulsif, volubile et rigoureusement stupide, Sobchak se trouve être un vétéran de la guerre du Vietnam, traumatisé par son expérience des combats. Catholique d’origine polonaise, on comprend au fil de l’intrigue qu’il s’est converti au judaïsme pour se marier avec son ex-épouse. Divorcé depuis lors, Sobchak n’a pas tourné le dos à la religion juive, loin de là ! Il semble même y avoir trouvé, en l’observant de manière stricte, un réconfort et quelques réponses. En témoigne une scène désormais culte, dans laquelle Sobchak fait reporter la date d’une compétition cruciale de bowling initialement prévue à Shabbat sous les yeux incrédules du Dude et de son ami Donny.
On notera, au passage, que The Big Lebowski figure au palmarès des films américains comptabilisant le plus de jurons, renforçant son côté marginal dans un Hollywood souvent étouffé par la bienséance. Mais revenons-en au fil rouge juif… Dans leur film, les frères Coen permettent au Dude de triompher d’une bande de nihilistes allemands grâce à Walter Sobchak. Des adversaires que ce dernier, mu par une vision manichéenne de l’humanité, assimile d’ailleurs plusieurs fois à des nazis. Dans son esprit comme dans celui du spectateur germe alors une intuition : et si Sobchak avait raison ? Ce qui se joue dans ce combat mi-épique, mi ridicule relève dès lors ni plus ni moins que du combat de civilisation. D’un côté les lumières juives, de l’autre, la folie destructrice d’aryens « qui ne croient plus en rien » !
Un cinéma de « shnorers », « shmoks » et « shlemazels »
« Il y a sans doute une part profondément juive dans le travail d’Ethan et Joel Coen, bien qu’ils ne soient pas religieux et que la judéité ne soit pas un thème dominant de leur cinéma », reprend Kaganski. « Mais l’humour juif ashkénaze (qui commence par se moquer de soi-même et de ses pires épreuves) imprègne leurs films, parfois de façon flagrante. A Serious Man débute par un conte yiddish qui fait figure de rareté absolue dans le cinéma américain contemporain, prologue dont le ton comique et sombre imprégnera tout le film. Leur filmographie abonde en déclinaisons américaines contemporaines de personnages typiques du folklore yiddish : on y reconnaît au fil des films des « schnorers » (mendiants/ ratés), des « shmoks » (crétins), des « shlemils » (maladroits), des « shlemazels » (malchanceux), des rabbins évidemment, et bien sûr des « mensh » (des hommes droits, des « serious men »), le plus drôle et paradoxal de ce défilé étant peut-être Walter Sobchak, le goy converti et devenu ultra sioniste joué par John Goodman dans The Big Lebowski ». Voilà donc comment une bande de shmoks a permis aux frères Coen de signer le long-métrage le plus culte de leur filmographie. Mais puisque nul n’est prophète en son pays, la réception de The Big Lebowski fut, à sa sortie du moins, très mitigée aux Etats-Unis. Pour preuve, le film n’a rapporté que 18 millions de dollars sur le territoire américain, soit à peine plus que son budget de 15 millions. Il faudra attendre son succès à l’internationale mais surtout le passage des années pour que les aventures du Dude connaissent un succès tardif mais amplement mérité.
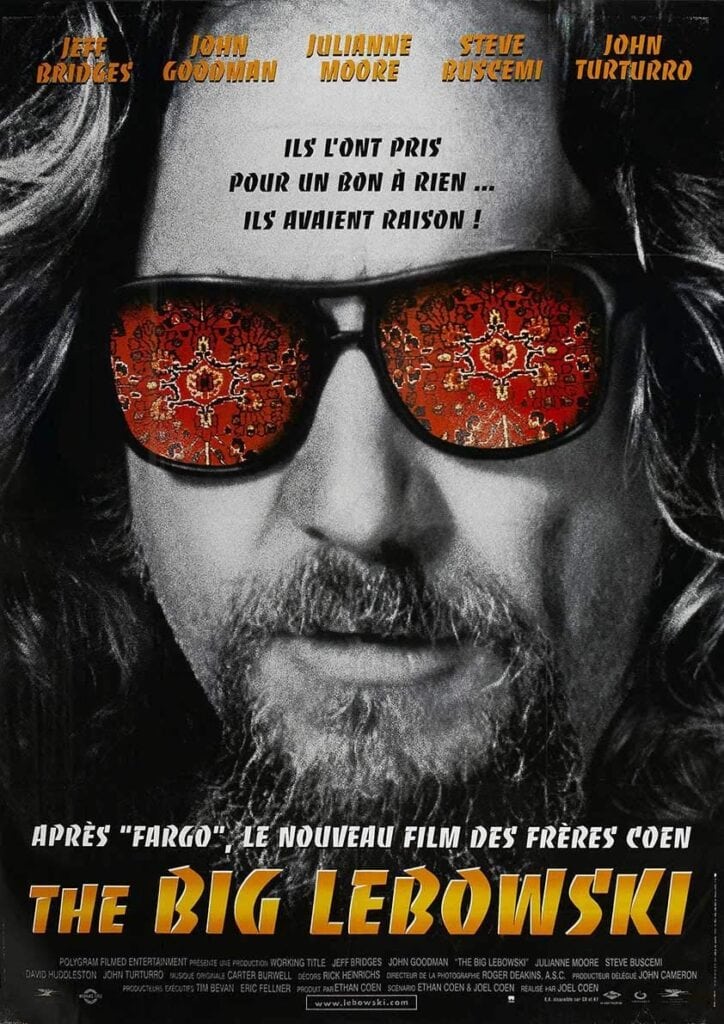
En bref
Sur une trame empruntée au Grand Sommeil de Raymond Chandler, on suit les aventures picaresques du Dude, Jeffrey Lebowski. Ce personnage d’apparence minable interprété par Jeff Bridges est un parfait glandeur passant son temps à fumer des joints, à siroter des cocktails White Russian et à jouer au bowling. À la suite d’une confusion d’identités, le Dude est agressé à son domicile car ses agresseurs le confondent avec un millionnaire également appelé Jeffrey Lebowski dont il finit par faire la connaissance. Lorsque la jeune épouse du millionnaire est enlevée, celui-ci fait appel au Dude pour apporter la rançon demandée par ses ravisseurs. Mais les choses commencent à mal tourner lorsque Walter Sobchak, le meilleur ami du Dude (interprété par John Goodman) projette de garder la rançon pour eux. Véritable ode à l’oisiveté et la non-performance, ce film deviendra un véritable film culte et sera même considéré par certains comme la meilleure thérapie pour surmonter le burn-out.