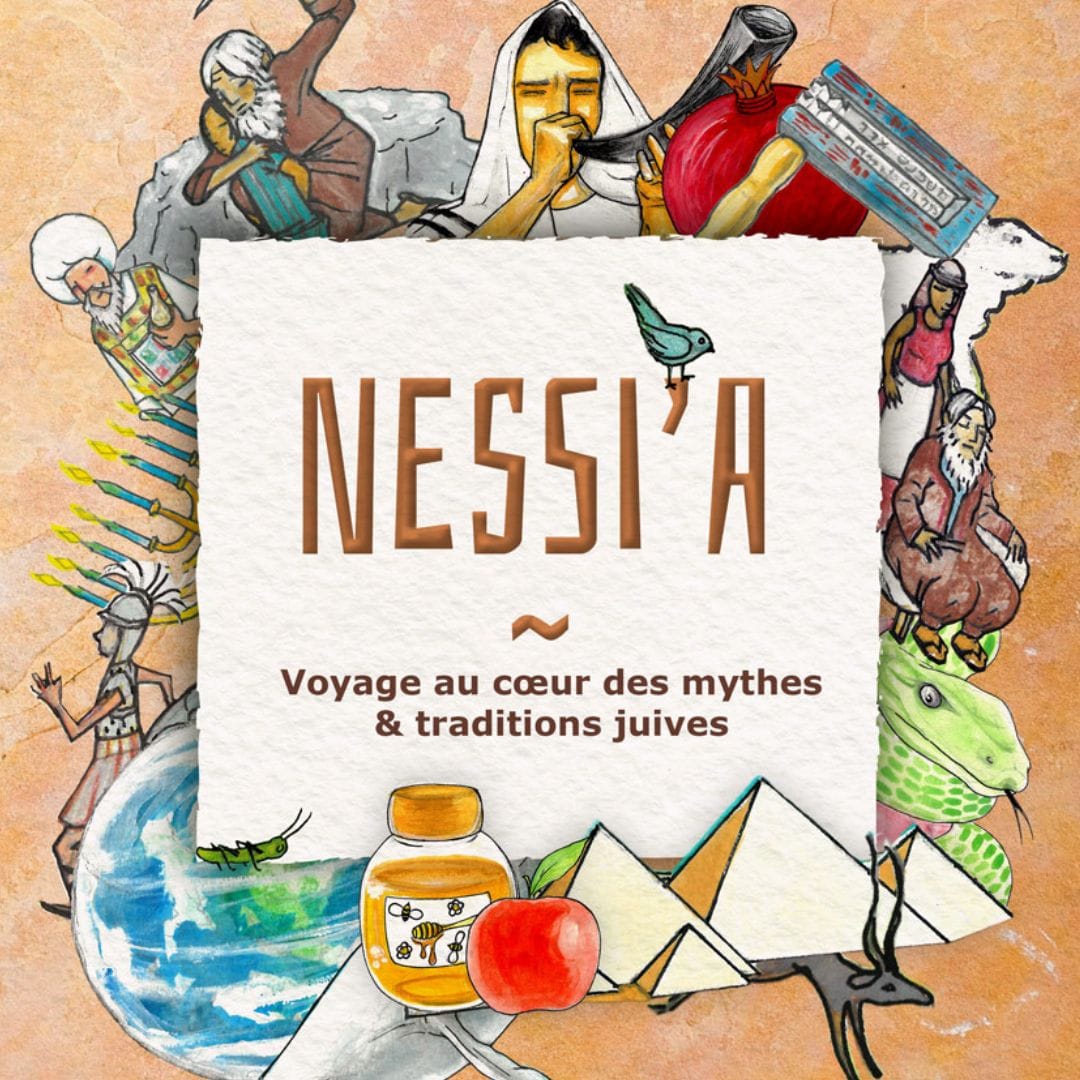Réélu pour cinq ans, Emmanuel Macron a battu Marine Le Pen mais trouve face à lui une France plus que jamais fracturée, divisée. Ecologie, fabrique du commun, fatigue démocratique, sauvegarde du modèle français : les défis qui lui font face sont désormais immenses.
Dimanche 24 avril, vingt-heures précises. Comme le veut la coutume cathodique, les chaines de télévision annoncent le grand gagnant de l’élection présidentielle en dévoilant son visage d’abord et son nom ensuite. Lorsque les traits du fringant quadragénaire Macron s’affichent à l’écran, on pousse évidemment un ouf de soulagement bientôt teinté de perplexité. Sommes-nous pour autant des Cassandre, d’éternels insatisfaits ? Evidemment, le président sortant remporte ce scrutin avec une certaine marge en atteignant 58,55% des suffrages exprimés. Bien sûr, une victoire présidentielle est toujours précieuse d’autant plus qu’elle est rare. D’ailleurs, Emmanuel Macron est le premier président réélu hors période de cohabitation.
Mais les voyants ne sont pas au vert pour autant. En 2017, ce dernier culminait à 66,10%. Il y avait du souffle et du charisme dans son surgissement et dans sa volonté de bouleverser la donne politique. On pouvait croire que le progressisme allait définitivement gagner la partie. Que nenni ! Cinq années plus tard, face à lui, au second tour, c’est encore et toujours Marine Le Pen qui fait office d’opposante numéro un. Une adversaire qui, suite à une campagne intelligemment menée aux quatre coins de l’hexagone, à bas bruit et auprès des classes défavorisées, ne cesse de progresser. Désormais largement dédiabolisée, la fille de Marine Le Pen obtient 41,45%. Cela signifie concrètement que plus de treize millions (13.297.760 pour être précis) d’électeurs ont déposé un bulletin d’extrême-droite dans les urnes. Un vote massif qui interroge. En affichant de tels scores, le Rassemblement national (RN) a-t-il véritablement perdu les élections ? N’est-il pas, depuis des années déjà et pour longtemps désormais, le parti le plus solide et le mieux ancré à l’échelle nationale ? Celui qui, plutôt qu’une formation gazeuse et impalpable, incarne avec simplicité et efficacité la réalité du terrain et la virulence du ras-le-bol qui, en France, prend parfois des tournures violentes ?
A cette première tendance, il faut en ajouter une seconde, là encore hautement prévisible : le score de l’abstention. Celui-ci atteint 28,01%, soit un taux inédit depuis 1969. La somme de ces indicateurs n’augure rien de bon pour les cinq années à venir, qui semblent désormais vouées à n’être qu’une succession de crises, une continuation du même climat houleux qui vit, au cours du premier quinquennat Macron, la naissance du mouvement Gilets Jaunes, la virulence du courant antivax, la montée inédite de la mouvance conspirationniste et l’inquiétante droitisation des esprits, jamais avare de fake news, de manipulations et d’enfumages.
Succès et déconvenues du « en même temps »
De ce magma contestataire émerge cependant une tendance indiscutable : l’ancien monde est englouti, les vieux partis patinent, la stratégie macroniste d’absorption des forces républicaines et progressistes a fonctionné. C’est ainsi le triomphe définitif du fameux « en même temps » permettant à des personnalités politiques historiques de la droite (Jean-Pierre Raffarin, Eric Woerth, Renaud Muselier, Christian Estrosi) et de la gauche (Manuel Valls, Jean-Pierre Chevènement, Marisol Touraine, Elisabeth Guigou) de se retrouver, pour un temps au moins, au sein de la même formation politique. Il y a là un tour de passe-passe inédit dans l’histoire de la Cinquième République, une redistribution des cartes que l’on pensait impossible et qui s’effectue pourtant efficacement, en dépit de la logique ancrée du bipartisme. Le macronisme est agile. Il n’est pas dogmatique.
En allant plus loin que le centrisme giscardien des années 1970, il permet aux uns de pouvoir joindre leurs forces aux autres et à tout ce petit monde de parvenir à travailler dans la concorde et sans heurts puisque les idéaux progressistes et européens les réunissent. Sauf que la manœuvre a aussi ses inconvénients. A la longue, les ralliements souvent sincères du « en même temps » donnent parfois l’impression de coups isolés, de débauchages opérés à la manière du charognard qui dépèce les restes des grands cadavres à la renverse que sont la gauche et la droite républicaines. Et surtout, cela accrédite la thèse de « l’UMPS » qui fut longtemps celle du Front National : autrement dit celle d’une union tacite de l’élite et du vieux monde pour gouverner en ne laissant aucune place aux formations politiques minoritaires. Dès lors, on ne s’étonnera alors pas que l’opposition soit acharnée, parfois tellement virulente que l’on s’étonnerait presque qu’un dirigeant de centre-droit puisse susciter un tel rejet épidermique. C’est en raison de ce rejet épidermique que 17% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon ont voté Marine Le Pen, contre leur intérêt. Ou bien encore que les territoires d’Outre-Mer, pourtant historiquement opposés à la possibilité de voir l’extrême-droite arriver aux portes du pouvoir ont cette fois-ci préféré voter pour la présidente du RN plutôt que pour Emmanuel Macron. Loin de la métropole, les chiffres sont éloquents et entérinent la détestation : Le Pen obtient 60,87% des voix en Martinique, 69,60% Guadeloupe, 60,70% en Guyane. Elle fait 59,79% à Mayotte et 50,69% Saint-Pierre-et-Miquelon. À la Réunion, elle est également en tête avec plus de 59,57% des bulletins.
Recréer du commun
Une France divisée. Une France profondément morcelée, dont les habitants se croisent moins et ne se côtoient plus. C’est le constat que dessinent d’essais en enquêtes des sociologues, des journalistes et des experts des principaux think-tanks hexagonaux. Au soir du premier tour, le constat s’était confirmé. Eclaté en multiples tendances, le scrutin n’avait alors pas permis à deux forces d’émerger distinctement mais plutôt à trois blocs de surnager dans le marasme : le vote pour Emmanuel Macron d’une part, celui des gagnants de la mondialisation, le vote pour Marine Le Pen d’autre part, celui du camp national, et enfin celui de Jean-Luc Mélenchon, vote utile à gauche, usant de ficelles populistes pour rassembler un camp social aux abois. « La question, c’est comment recoller cette France archipélisée ? Comment recréer de la cohésion nationale, de cohésion sociale ? Comment porter un message populaire ? », s’interroge Jérémie Peltier, chercheur à la Fondation Jean Jaurès.
"L’enjeu, c’est d’aller au-delà de sa base. Pour Emmanuel Macron, il s’agira en l’occurrence d’aller chercher les jeunes"
Jérémie Peltier, chercheur à la Fondation Jean Jaurès
« En gros, l’enjeu, c’est d’aller au-delà de sa base. Pour Emmanuel Macron, il s’agira en l’occurrence d’aller chercher les jeunes ». Il faudra également rebâtir l’idée même de destin commun, qui a du plomb dans l’aile. C’est là un problème récurrent en France. Une obsession parfois, depuis la création du ministère de l’Identité Nationale sous Nicolas Sarkozy. Sans savoir qui nous sommes, impossible d’avancer vraiment. « A maints égards, nous vivons désormais dans une société de vies parallèles, qui est un poison lent pour les démocraties », explique l’éditorialiste Anne Rosencher. « Est-ce parce que, désormais, certaines France ne se croisent quasiment plus ? Que les prix de l’immobilier ont dessiné une partition sociale et culturelle du territoire ? Que l’école est de moins en moins mixte, que les bancs des églises sont désertés et que même les colonies de vacances sont très segmentées ? Il faudra des volontés et des volontaires pour faire comprendre aux bataillons du premier degré que penser contre soi n’est pas forcément “faire le jeu” de l’adversaire ». La bataille promet d’être rude…
Avec qui gouverner ?
Ce dimanche 24 avril au soir, face à la Tour Eiffel, après une courte marche accompagnée d’enfants menée au son de l’hymne européen, un DJ s’évertuait à faire danser la foule macroniste comme on danse sur un volcan. Et tandis que One More Time de Daft Punk faisait remuer quelques popotins ministériels, d’aucuns estimaient, tel Mediapart, qu’« Emmanuel Macron domine un champ de ruines », les fractures « n’ayant jamais été aussi béantes ». Dans son discours de victoire, le président désormais conforté dans ses fonctions a promis une « méthode collective refondée » et promet « cinq années de mieux » et une « société plus juste ». L’attente est immense. « Nous avons tant à faire », reconnait-il. « Nous devrons être bienveillants et nul ne sera laissé sur le bord du chemin », a assuré le premier des Français. Pour ce nouveau quinquennat, le locataire de l’Elysée devra montrer patte blanche. Il se pourrait bien, d’ailleurs, que le vrai travail commence maintenant, comme le signifie justement l’intellectuel écologiste Jean-Marc Jancovici : « Il reste le plus dur : accoucher d’une vision en phase avec les défis de l’époque, qui donne du souffle et de l’espoir à la population, et qui n’apparaisse pas juste comme une réaction à la dernière “crise”. En gros, avoir une lecture du monde « tel qu’il est » qui permette d’anticiper de manière pertinente, d’agir sans prétendre transgresser la physique, et de donner à chacun un rôle dans le projet d’ensemble ». Tout doit être repensé : les mots, la méthode et peut-être aussi les hommes qui accompagnent les réformes. Emmanuel Macron a laissé entendre qu’il s’accompagnerait d’une équipe ouverte et renouvelée. Au lendemain de la victoire, à l’heure où s’écrivent ces lignes, Paris bruisse déjà des noms de potentiels ministrables qui pourraient rééquilibrer un premier mandat résolument marqué à droite : Nicolas Notat, ex-syndicaliste de la CFDT, François Rebsamen, transfuge du Parti socialiste, Pascal Canfin historique des écolos. Autant de noms qui permettraient au macronisme d’inaugurer un visage plus fédérateur et rassembleur. En off, on nous l’assure : « Emmanuel Macron a compris la leçon ».