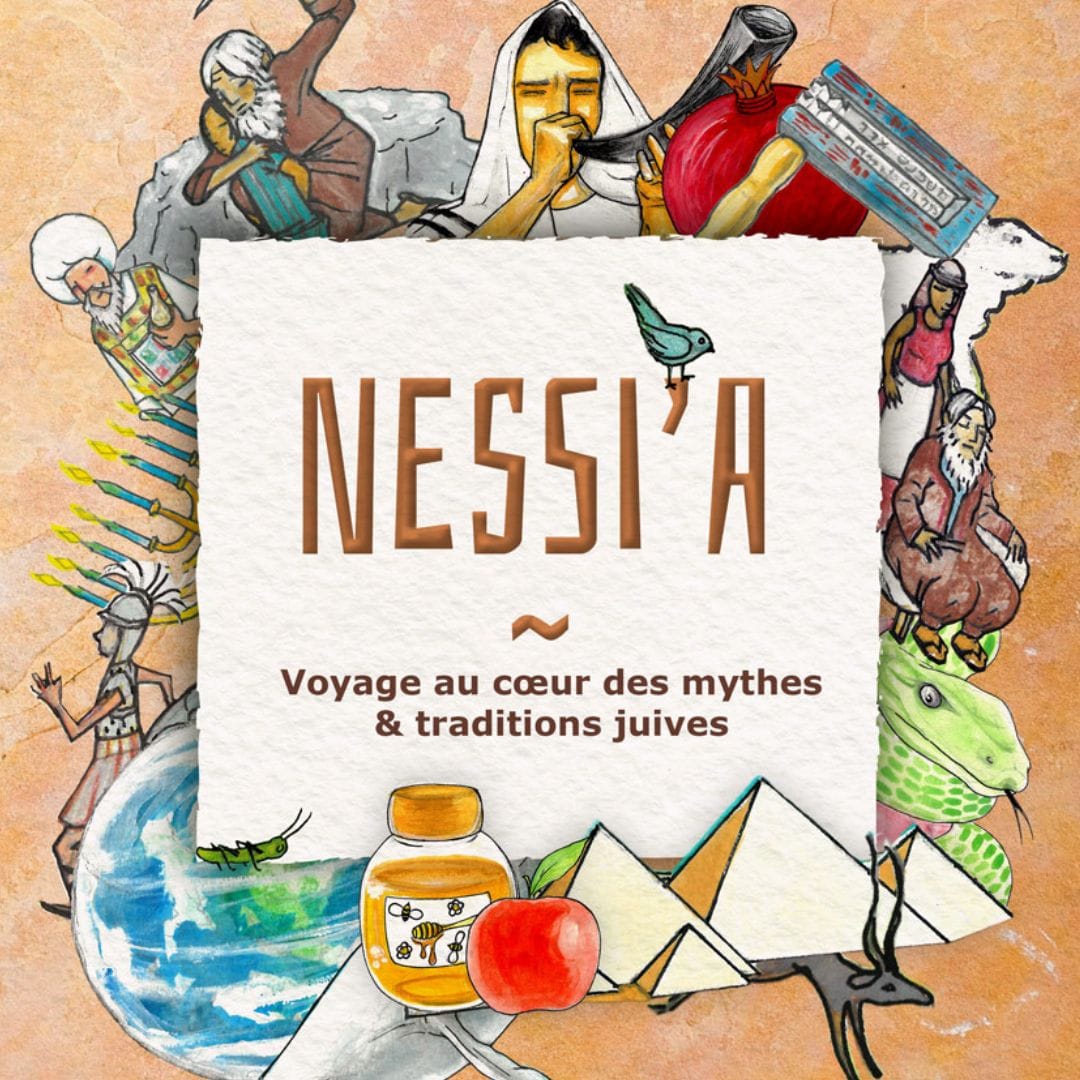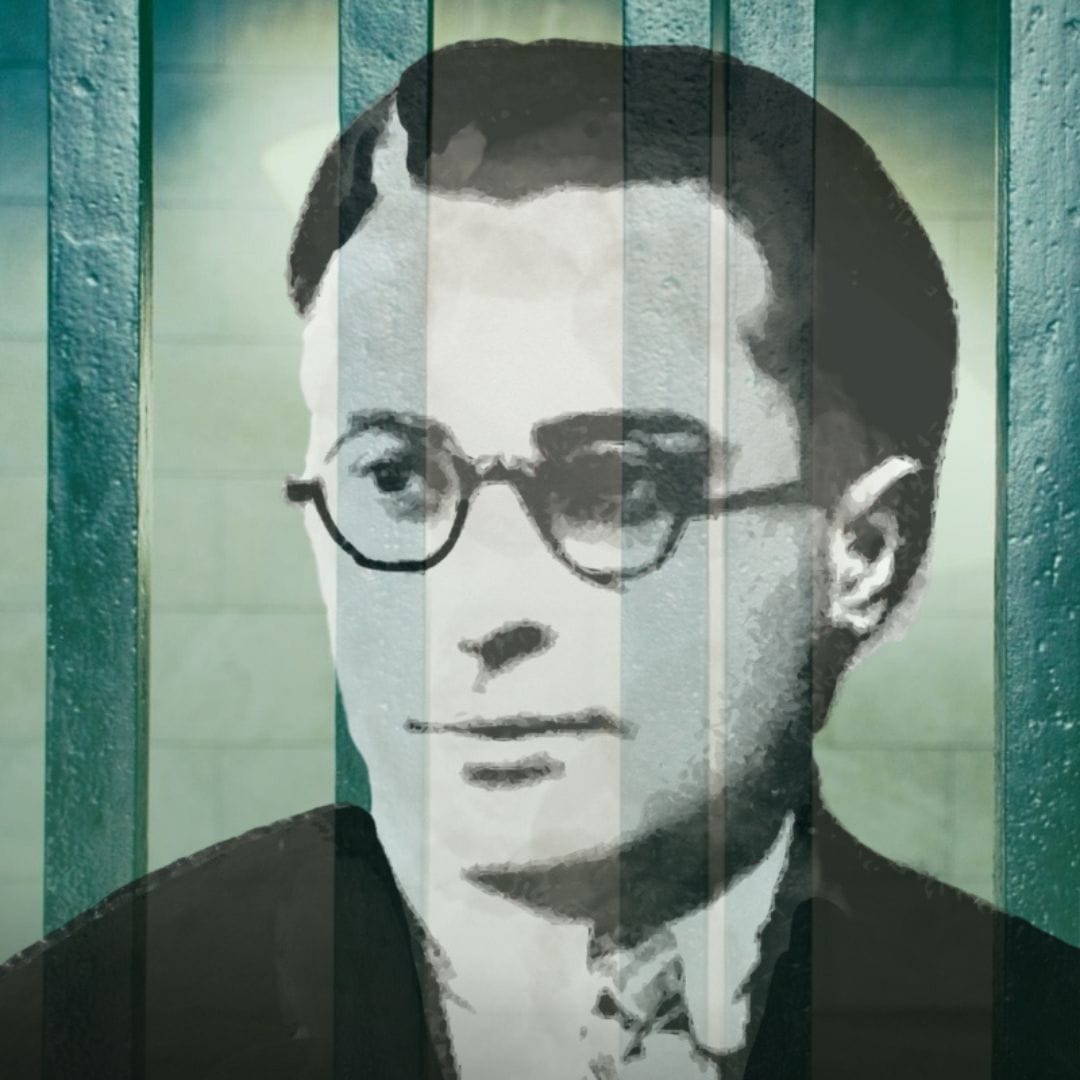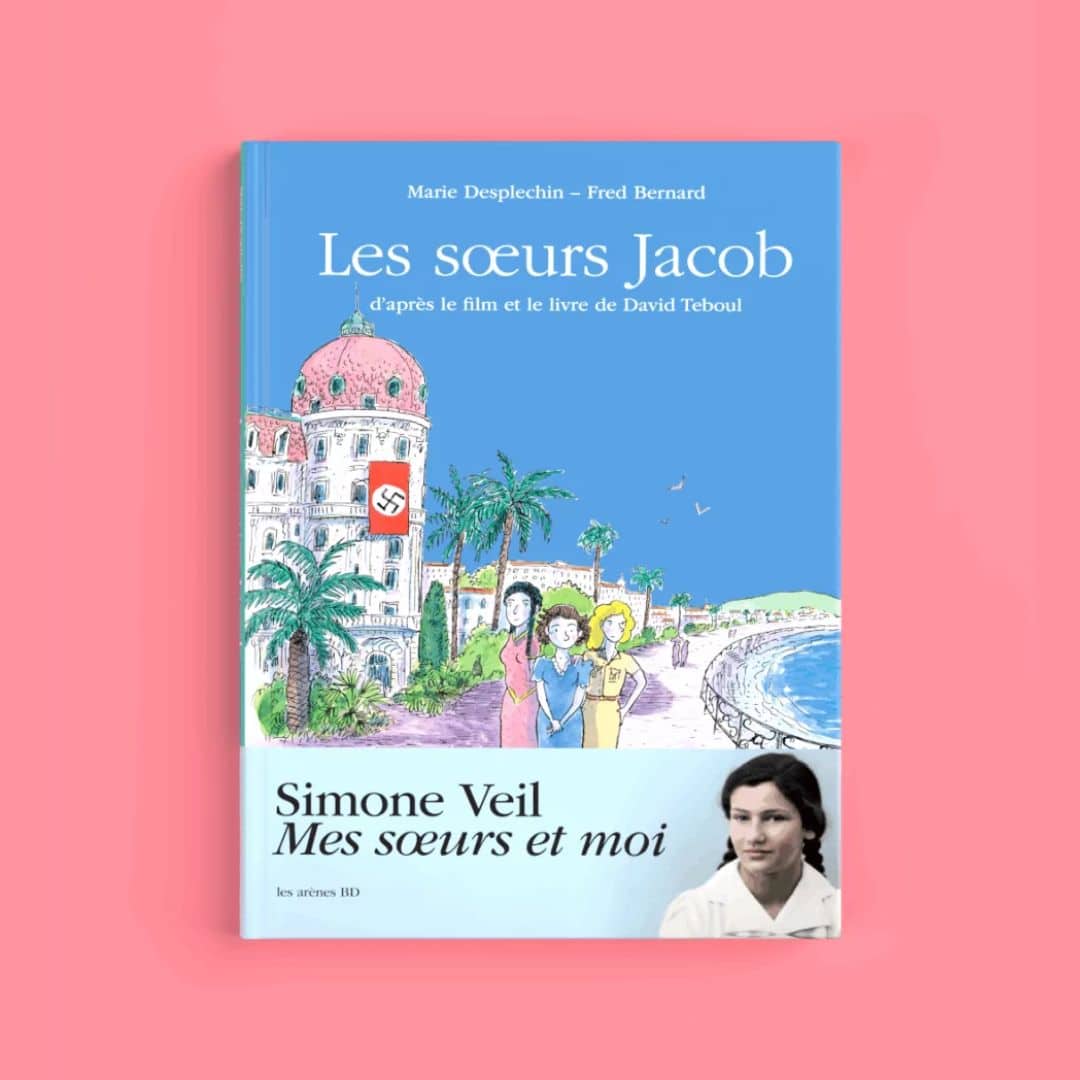En plein Qatargate, Israël peine à se projeter dans un après-guerre à Gaza sans le Qatar, si nuisible pour ses intérêts, mais dont il a aussi besoin.
Assiste-t-on aux derniers jours du Qatar à Gaza ? L’incontournable médiateur entre Israël et le Hamas va-t-il être écarté au profit de ses voisins du Golfe, émiratis ou saoudiens ? Beaucoup l’espèrent à Jérusalem et Washington, en échafaudant de nouvelles stratégies. Celle ayant fait du Qatar le grand argentier du Hamas a tragiquement échoué le 7-Octobre. Les sommes astronomiques transférées dans l’enclave après l’opération de 2014 – on parle au total de 1,8 milliard de dollars – n’ont servi ni à aider les civils gazaouis ni à responsabiliser le Hamas, mais au contraire à lui permettre de se renforcer en vue de commettre ses massacres. De même, la proximité du Qatar avec l’Iran et les Frères musulmans, notamment les dirigeants politiques du Hamas qu’il héberge depuis 2016 dans ses palaces, en font un médiateur ambigu. Le Qatar diffuse la propagande du Hamas sur sa chaîne Al Jazeera et finance les campagnes propalestiniennes sur les campus. Sous pression américaine, il s’est résolu à expulser des membres du Hamas vers Ankara, où Erdoğan se pose en nouveau défenseur des Palestiniens. Doha a même un temps suspendu sa médiation. Et fin mars, l’émissaire de Trump pour les otages a osé négocier directement avec le groupe terroriste, au grand dam d’Israël.
Car si le médiateur qatari devait quitter la scène après-guerre, les Israéliens rêvent d’y voir à la place un autre État du Golfe, à commencer par les Émiratis déjà investis à Gaza. A priori, Doha et Abou Dabi se ressemblent : deux petits Émirats avec une faible démographie, surtout en comptant les seuls nationaux (300.000 au Qatar, un peu plus d’un million aux Émirats), mais aussi deux richissimes géants des hydrocarbures, décidés à diversifier leur économie et étendre leur influence. Quand Abou Dabi cible l’immobilier et les transports au Moyen-Orient et dans la Corne de l’Afrique, l’émir qatari Tamim ben Hamad Al Thani mise sur le sport et les médias comme outils de soft power plutôt tourné vers l’Europe et l’Asie. Surtout, leurs trajectoires se sont séparées en 2011 à la suite de l’irruption du Printemps arabe et la montée en puissance des Frères musulmans. Le Qatar a maintenu ses liens avec Téhéran et des groupes djihadistes tandis que les autres monarchies du Golfe prenaient leurs distances, à la fois par crainte d’être assimilées au terrorisme et d’en être elles-mêmes la cible. Les Émirats se sont rapprochés d’Israël jusqu’à en faire un partenaire contre la Turquie, les Frères musulmans et l’Iran. D’autant que leur alliance scellée par les Accords d’Abraham en 2020 leur permet de renforcer celle avec les Américains.
Jusqu’à présent, les Émirats ont été parmi les plus actifs à Gaza à travers l’action humanitaire : distribution de 40.000 tonnes d’aide alimentaire et médicale, fondation d’un hôpital de campagne, rénovation du réseau de distribution d’eau. Leur arrivée dans le jeu politique gazaoui devrait sonner la fin du Hamas, dont ils exigeront le départ. Elle pourrait aussi entraîner cette refonte de l’Autorité palestinienne que Washington appelle de ses vœux. Ils hébergent en effet depuis 14 ans Mohammed Dahlan, l’ancien conseiller à la Sécurité nationale de Mahmoud Abbas, devenu un proche du Prince Mohammed Ben-Zayed (MBZ). Artisan de la normalisation entre Abou Dabi et Jérusalem, Dahlan s’est illustré comme le superviseur de l’aide à Gaza pendant la guerre. Son nom est discuté dans les cercles israéliens pour diriger une force intérimaire de sécurité, voire prendre les rênes de l’enclave. Originaire de Khan Younès, cet ancien chef des services de sécurité de l’Autorité palestinienne à Gaza (1994-2002), devenu un homme d’affaires multimillionnaire, a l’avantage de n’être lié ni à l’Autorité palestinienne, qui l’avait exilé pour corruption, ni au Hamas, dont il fut un ennemi juré. « Dahlan est l’hypothèse qui revient depuis quelques temps et pourrait convenir tant à Abou Dabi qu’à Jérusalem et Washington », nous explique Jean-Loup Samaan, chercheur au Middle-East Institute de l’Université nationale de Singapour. « Mais Dahlan s’est fait beaucoup d’ennemis à Gaza et Ramallah. » Trop peut-être pour faire figure d’homme providentiel pour l’après-guerre.
L’espoir d’une normalisation avec Riyad
Avec la carte saoudienne, les Israéliens rêvent de changer d’échelle : la participation de Riyad à la reconstruction de Gaza – estimée à plus de 50 milliards de dollars – s’enchâsserait dans un vaste plan régional pouvant conduire à l’élargissement des accords d’Abraham. C’est en tout cas le vœu de Trump. Quant au prince héritier Mohammed ben Salmane (MBS), sa priorité va à la modernisation de son royaume avec le plan « Vision 2030 ». Il ambitionne aussi de retrouver le leadership diplomatique initié par le roi Fayçal dans les années 1970. « Pour les Saoudiens, le rôle du Qatar a toujours été une aberration, car du point de vue géographique, économique, démographique, c’est un petit État indigne de médiation. D’où le blocus contre lui en 2017-2021. C’est aux Saoudiens que ce rôle devrait échoir : eux sont la seule puissance régionale », souligne Jean-Loup Samaan. D’ailleurs, si Doha a pu s’imposer comme médiateur au Liban et à Gaza, c’est après que Riyad s’en soit désengagé.
Le récent sommet américano-russe sur l’Ukraine organisé à Djeddah signe le retour des Saoudiens dans la course régionale à la médiation. Pour autant, ils ne sont pas pressés de plonger dans le bourbier de Gaza. Ils ont certes critiqué le plan Trump visant à transformer l’enclave en « Côte d’Azur » et reçu fin février à Riyad les six pays du Golfe et les dirigeants égyptien et jordanien pour imaginer un projet alternatif. Mais quand l’Égypte a fait voter un plan sur le retour de l’Autorité palestinienne sans déplacement des Gazaouis lors du sommet de la Ligue arabe au Caire le 4 mars, deux dirigeants brillaient par leur absence, soucieux de ne pas s’aliéner Trump : MBZ et MBS.
Les Américains vont-ils convaincre ce dernier de se rapprocher d’Israël ? C’est prématuré, temporise Jean-Loup Samaan : « Il existe un décalage entre un discours en Israël très confiant sur la capacité de Trump d’obtenir quelque chose des Saoudiens et ce qu’on entend à Riyad, qui apparaît beaucoup plus prudent. » Les Saoudiens sont désormais plus conciliants envers l’Iran, comme en témoigne l’accord de réconciliation signé à Pékin en 2023. Par ailleurs, on sait que le prince héritier saoudien conditionne toute normalisation avec Israël aux progrès sur la création d’un État palestinien dont Netanyahou et ses alliés annexionnistes refusent d’entendre parler. Du moins MBS le veut-il officiellement. « Est-ce que je me soucie personnellement de la question palestinienne ? », aurait-il demandé selon des informations publiées dans The Atlantic. « Non, mais mon peuple, lui, s’en soucie. Je dois donc m’assurer que cela ait un sens. »
Reste que le Qatar est toujours présent malgré les efforts émiratis et saoudiens pour le marginaliser. Très compétitif sur la médiation, il est intervenu sur tous les terrains diplomatiques : à Gaza, mais aussi au Liban, Yémen, Darfour, en Afghanistan, Somalie et Kenya, au Venezuela, en Iran pour la libération de prisonniers américains, et encore récemment au Congo. Malgré ses liens avec le Hamas, il a conservé la confiance de Washington. Le Qatar accueille l’immense QG du CENTCOM (le commandement central américain) sur la base aérienne d’Al Udeid, les Américains ayant également accès au port de Hamad. Plus encore, l’Administration Biden lui a accordé en janvier 2022 le statut d’allié non-membre de l’OTAN – dont ne bénéficie même pas l’allié historique saoudien – et, fait unique dans le monde arabe, a levé fin 2024 l’obligation de visa d’entrée pour les citoyens qataris.
Israël et le Qatar, les « frenemies »
Les excellentes relations de Doha avec Washington expliquent l’ambivalence de sa relation avec Israël. D’un côté les Qataris appuient la propagande du Hamas ; de l’autre, ils ont noué des relations secrètes avec Israël depuis 1996, reçoivent discrètement des responsables du Mossad et de Tsahal et sont d’indispensables facilitateurs avec le Hamas et l’Iran. « Le terme le plus approprié pour décrire ces relations est celui de ‘‘frenemies’’, à la fois ennemis et alliés », résume l’historien Elie Podeh de l’Institut Mitvim. « Le Qatar va exercer toute son influence pour rester à Gaza “le jour d’après”, mais Israël devrait réduire son rôle autant que possible », plaide-t-il, tout en louant ses efforts dans la libération des otages.
Doha a justement pris contact avec les familles des otages pour améliorer sa réputation en Israël. Mais il y a plus. La police et le Shin Bet enquêtent sur trois conseillers de Netanyahou qui auraient obtenu des millions d’euros du Qatar pendant la guerre pour promouvoir son image. Un homme d’affaires israélien qui a servi d’intermédiaire confirme que l’un d’eux, Eli Feldstein, ancien porte-parole du Bureau du Premier ministre pour les affaires militaires, a été payé par le Qatar, car le gouvernement israélien ne pouvait plus lui verser son salaire après que le Shin Bet lui a refusé l’habilitation de sécurité. Or, Feldstein est par ailleurs accusé d’avoir fait fuiter des documents secrets pour convaincre l’opinion israélienne de poursuivre les combats. Baptisée « Qatargate » par la presse, l’affaire éclabousse le Premier ministre. Son empressement à limoger le chef du Shin Bet et la procureure générale qui a ouvert l’enquête alimentent les soupçons. De même que sa décision de reprendre les combats et son incapacité à présenter une stratégie de sortie de guerre. À se demander si, vraiment, Israël souhaite se débarrasser du Qatar.