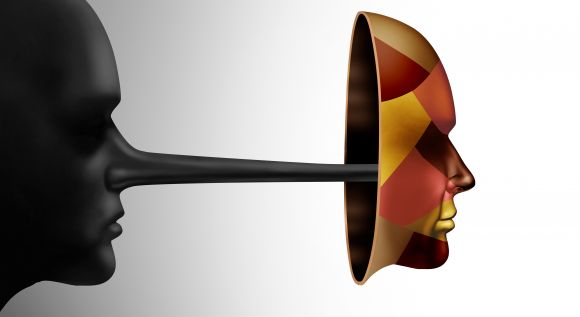Après plus d’un an de crise sanitaire et de confinements nécessaires, la culture a enfin commencé à timidement (le virus et ses variants n’ont pas disparu, les protocoles et les jauges non plus) renaître. Pour certains, c’est le cinéma et le théâtre qui manquaient, pour d’autres, c’est l’impatience de retrouver la magie des concerts qui est en ébullition.
Mais on le sait, les doctrines (« dogmes » serait peut-être plus approprié) sociologiques made in USA qui tempêtent sur nos réseaux sociaux et, malheureusement, de plus en plus, sur nos médias dits « mainstream », s’attaquent régulièrement, depuis quelques années, à des œuvres d’art, contemporaines ou anciennes, en sortant les cartons rouges appropriés.
La « Cancel culture », que beaucoup s’obstinent à ne pas vouloir voir, consistant à tenter de faire interdire une œuvre ou un artiste qui, pour diverses raisons, ne rentre pas dans le cadre désiré, est un vrai danger. Et le motif le plus inquiétant à ces annulations militantes reste l’appropriation culturelle. Alors que, nous l’espérons, la vie des artistes va progressivement retrouver un semblant de normalité, le moment est sans doute idéal pour tordre le cou, une fois pour toutes, à ces tentatives de cloisonnement.
Le désir de s’agripper aux autres cultures
« Grandir en tant que fils de diplomates et voyager autant, puis, voyager autant en raison de mon travail, mais aussi, être juif, c’est-à-dire avoir une tradition de nomades, de peuple sans pays, et, enfin, être israélien, d’un pays de tant d’immigrants, un melting-pot… Tout cela crée chez moi la sensation d’être « sans maison ». C’est difficile dans ma vie personnelle mais, en tant qu’artiste, je pense que c’est très bénéfique, cette idée de ne pas être connecté à une tradition spécifique, une voix, un panel précis de règles. Mais ce sentiment d’être sans racines crée un personnage qui est constamment en recherche de connexion à quelque chose. (…) C’est ce qui me dirige en tant qu’artiste ». C’est ainsi que l’auteur-compositeur-interprète israélien Asaf Avidan, actuellement en pleine tournée de son dernier album, Anagnorisis, analyse son identité personnelle.
Une variété de « je » qui se retrouvent sans conteste dans son travail. Comme tout bon artiste, il est exhibitionniste, mais pas narcissique : il « s’exhibe », se met à nu, dévoile ses tripes, ses peurs et ses failles, mais ce qui l’intéresse c’est – de son propre aveu – de les voir à travers le regard de l’autre et de mieux se comprendre grâce à ce regard étranger. Son absence de racines précises et bien délimitées, et le manque intime que cela génère, est ce qui lui donne l’impulsion, le désir de s’agripper à d’autres cultures, d’autres personnes. Si les influences de Bob Dylan et Leonard Cohen (ou, plus récemment, Bowie) sautent aux oreilles, Avidan est de tous les styles, de tous les horizons, toutes les nations. On est dans l’Americana, puis, soudain, au Moyen ou Extrême-Orient, en passant par la Jamaïque ou l’Italie. La très présente guitare cède sa place à la cithare, qui semble la disputer au bouzouki. Son chant déploie mille voix, depuis son timbre « joplinien », il voltige de la folk au gospel en passant par des vocalises arabisantes. Les frontières de la peau, du sexe ou de la terre ne semblent pas le préoccuper le moins du monde, et fort heureusement, car c’est cette multitude de sonorités qui rendent éblouissant le voyage musical qu’il nous propose.
Mettre les paras au pas
En musique, la mixité devient parfois la raison d’être du morceau. Serge Gainsbourg, que l’on célèbre en cette trentième année de sa disparition, s’est approprié tout son soûl. Et remercions le bon esprit qui lui a soufflé cet instinct, car son génie tenait, entre autres, à sa liberté culturelle totale. Sa puissance créatrice y réside pour partie. Son appropriation du reggae lui a, elle, permis de « mettre les paras au pas » et d’ainsi marquer l’Histoire de la chanson française. En ce 4 janvier 1980, forcé d’annuler un concert à Strasbourg, il montera, malgré tout, sur scène pour chanter l’hymne national devant les responsables, ces anciens bérets rouges venus se glisser dans la salle pour le saboter, avant de leur adresser un magnifique bras d’honneur. Paras dont il dira sans ménagement que ce qui les faisait « chier » c’était, bien entendu, « de voir un Juif chanter la Marseillaise avec des Noirs ». Mixité et double « appropriation » ont fait merveille et mis les extrémistes de droite hors d’eux. Ce qu’il nous en reste ? Un moment d’anthologie de saine provocation et une chanson qui, aujourd’hui, aurait peut-être, paradoxalement, fait hurler des partisans de l’autre bord de l’échiquier politique.
Western, Mexique et Yakuzas
Côté cinéma, les rumeurs vont bon train concernant le prochain (et dernier) film de Quentin Tarantino. Et si ce génie moderne est profondément imprégné par sa culture américaine, il ne s’est pas privé pour aller voir ailleurs.
Kill Bill (Vol. 1 et 2), ce monument du cinéma, n’est qu’ « appropriation culturelle » et juxtaposition de codes dans un chaos soigneusement pensé… et c’est ce qui en fait un chef-d’œuvre. Il est bien heureux que Tarantino se soit approprié sans vergogne la culture chinoise pour ses scènes en théâtre d’ombres ainsi que pour son exploration du Kung Fu. Il est heureux qu’il se soit jeté avec délice dans la culture nippone, que ce soit par l’omniprésence des katana (en ce compris leur fabrication), l’utilisation de thèmes et bruitages, ou l’insertion d’une section de film en animé japonais. Il est heureux qu’il ait eu l’intelligence de souligner leracisme dont est victime une sino-japonaise (la sublime Lucy Liu) parmi les yakuzas, avant de montrer le mépris de celle-ci à l’égard de « la stupide petite fille caucasienne [qui] aime jouer avec des sabres de samouraïs ». Il est heureux que dans ces deux opus, se soient mêlées avec une telle harmonie, l’Asie, les Etats-Unis et le Mexique. Finir un film de chasseurs de primes ricains semblant sortis du Far West, mais armés de katana, par Malagueña salerosa, célèbre chanson mexicaine, il fallait y penser. Et pour cause, lorsque vibre le générique final du second volet, on frissonne. Ce film complètement fou, capable de nous montrer un combat de sabres géant sur fond de musique twist, se contrefoutait des conventions culturelles. Tarantino s’approprie, mélange sans scrupules, et il a bien raison. C’est pour cela que ce film est si grand et restera, sans doute, le meilleur de son œuvre.
L’Art n’est pas une A.O.C.
Alors non, la culture n’est pas hors-sol – ce n’est pas pour rien que l’on parle de « racines ». Elle vit de paysages, de climats, de langues et d’Histoire. Mais cela ne la rend pas hermétique, inerte ou interdite d’accès à qui s’y intéresse. Oui, on peut transporter des bouts de culture avec soi, piocher dans celles que l’on croise, tenter, surtout, de faire entrer en résonance tous ces morceaux d’humanité, ces visages et sons différents. C’est ce qu’on appelle la création. L’art n’est pas une AOC, un produit de consommation labellisé avec traçabilité « lieu de production ». S’il faut être noir pour parler d’esclavage ou de la « condition noire », juif pour parler de la Shoah ou du judaïsme, homosexuel pour traiter des émeutes de Stonewall ou de l’amour entre femmes, alors autant admettre tout de suite que l’Art est mort.
Fort heureusement, nombreux sont ceux qui ne se sont jamais préoccupés de jeter ne serait-ce qu’un regard sur ces frontières répugnantes. Nombreux sont ceux qui ont tenu à parler de l’Autre autant que d’eux-mêmes, à mêler les corps, les sonorités et les langues, à peindre avec passion, comme le groupe Feu ! Chatterton, l’amérindienne icône mexicaine qu’est La Malinche, quand chanteur et musiciens vivent à Paname, à livrer, comme Abdellatif Kechiche, leur interprétation si humaine de La vie d’Adèle, quand leur condition masculine aurait pu les disqualifier, ou à conter, comme Wes Anderson avec sa magistrale Île aux Chiens, un Japon dystopique mais éblouissant, en étant natif de Houston, Texas. Que vivent les voyages et les rencontres, que vive la chaotique altérité, et, surtout, appropriez-vous, nom de D. !