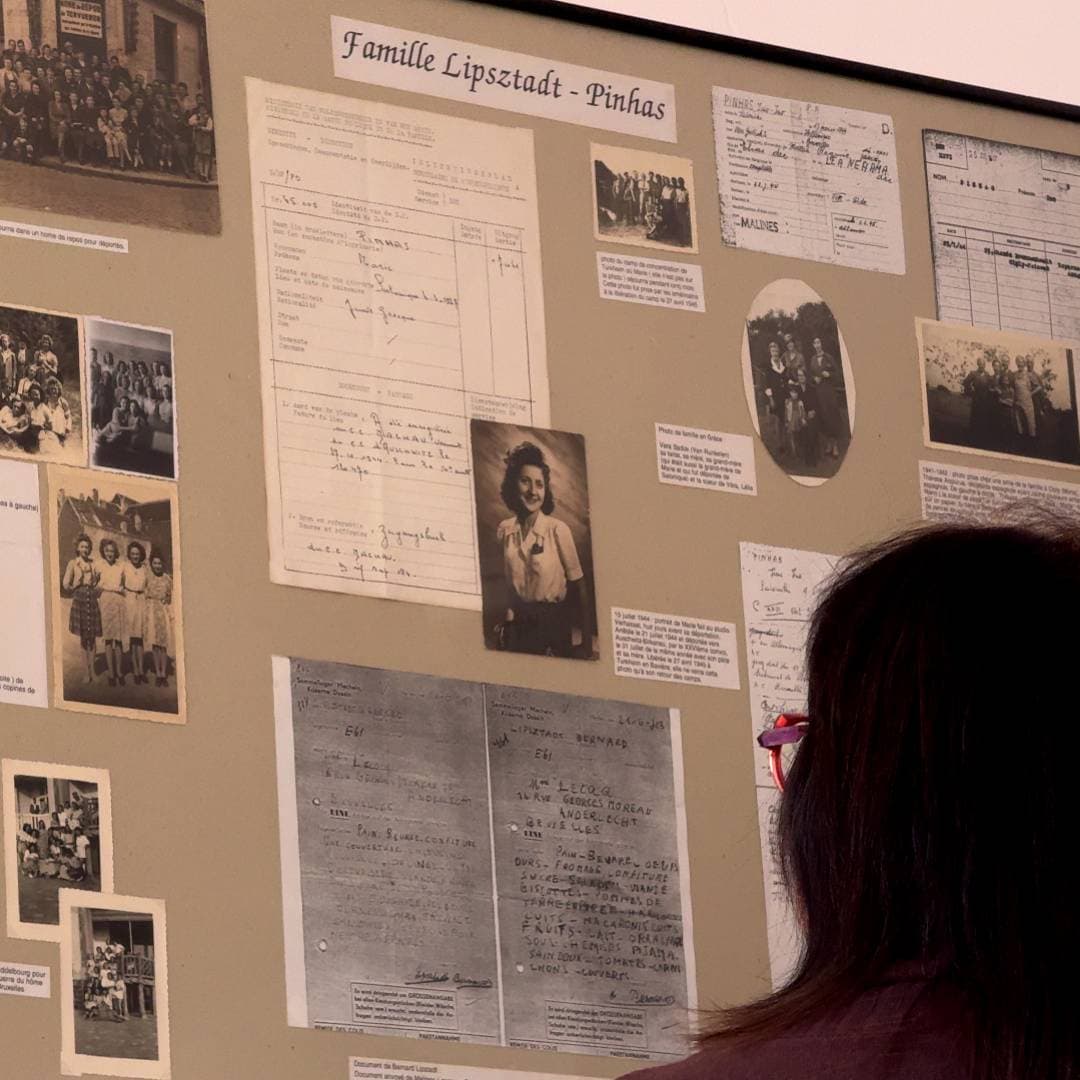Ecrivain et critique littéraire, Henri Raczymow vient de publier “L’arrière-saison des lucioles” (éd. L’Antilope). Dans ce récit, il revient sur les moments essentiels de son parcours littéraire en évoquant les livres et les personnes qu’il ne veut pas voir tomber dans l’oubli. De Jabès à Levinas, en passant par Proust, Modiano et même le camarade Henri Krasucki, cette balade littéraire a le mérite d’éclairer avec style et autodérision de nombreux aspects de l’identité juive contemporaine.
Vous avez intitulé votre dernier livre "L’arrière-saison des lucioles". Est-ce une manière plus élégante de parler d’inventaire avant liquidation ?
Henri Raczymow : C’est une manière métaphorique de dresser le bilan mélancolique de mon parcours littéraire tout en portant un regard distancié et quelques fois amusé sur celui-ci. Ce que j’écris m’apparait de plus en plus comme les scintillements des lucioles dans la nuit : leurs signaux faibles sont éphémères. Mais j’écris pour que tout ce monde littéraire ne tombe pas dans l’oubli ni dans l’effacement. Ce n’est peut-être qu’une illusion de croire que dans vingt ans, trente ans ou un siècle après sa disparition, l’écrivain sera encore lu et évoqué. Les livres seront sûrement rangés au fond une bibliothèque poussiéreuse et par hasard quelqu’un les lira. C’est l’idée que je me fais de la postérité. Elle n’est ni grandiose ni mégalomaniaque.
Pour la génération d’après la shoah à laquelle vous appartenez, celle née dans les années d’après-guerre, s’agissait-il nécessairement d’écrire la perte ?
H.R. : Cela ne fait aucun doute. Il en va ainsi dans mon rapport au yiddish. Aujourd’hui, certaines personnes apprennent cette langue comme s’ils apprenaient le quechua. Ce n’est pas mon cas parce que le yiddish est la langue de mes parents et de mes grands-parents, et aussi une langue liée à la perte. Par définition, cette langue est tragique. J’écris donc contre cette perte comme si j’aménageais des polders pour éviter que des territoires soient engloutis par la mer. L’écriture me permet de gagner du terrain. C’est à la fois nécessaire et vain car l’oubli, la perte et l’effacement sont très forts. Ma génération est née dans un trou où régnait le silence. Nos parents ne nous ont pas transmis la mémoire de la shoah par des mots mais par de l’infra-langage. Nous sommes nés avec ça, cette imprégnation d’on ne sait quoi, c’est-à-dire avec cette connaissance intuitive de la shoah. Tout cela se faisait dans le silence mais un silence lourd. Dans les années 1970 et au début des années 1980, nous parlions de « seconde génération » sans savoir qu’il y en aura une troisième génération portant aussi en elle-même le tourment intime et le même poids de la shoah.
Vous n’écrivez pas pour « venger votre race » comme l’écrivait il y a soixante ans dans son journal intime Annie Ernaux, lauréate du prix Nobel de littérature 2022 ?
H.R. : Pas du tout même si j’apprécie beaucoup l’œuvre d’Annie Ernaux. Il n’y a pas du tout de vengeance chez. J’y vois surtout l’idée d’une mutation. Mes parents, immigrés juifs polonais, n’ont pas fait d’études. J’aurais pu reprendre la boutique, dans tous les sens du terme, et travailler à mon tour dans les shmates. Sauf que nos parents aspiraient à ce que nous faisions des études universitaires. Bien souvent, c’est qui se passait. On passait en une seule génération de chiffonnier à professeur d’université. Nos parents avaient une sorte d’ambition très élevée pour leurs enfants. Qu’ils soient les premiers à l’école, qu’ils réussissent dans la vie… Cette idée de vengeance est donc tout à fait absente car il n’y a pas de trahison. C’est plutôt un achèvement en raison de l’adéquation entre leurs aspirations et les nôtres.
C’est entre la fin des années 1970 et le début des années 1980, dans ce que vous appelez le « reflux de Mai 68 » que, comme nombre de Juifs de votre génération renouent avec votre leur judéité. Dans quelle mesure la parole de Levinas sur la perte de l’identité juive si souvent citée vous a influencé ?
H.R. : Oui. Dans Difficile liberté, Levinas écrit : « S’interroger sur l’identité juive, c’est déjà l’avoir perdue. Mais c’est encore s’y tenir, sans quoi on éviterait l’interrogatoire. Entre ce déjà et cet encore, se dessine la limite, tendue comme une corde raide sur laquelle s’aventure et se risque le judaïsme des juifs occidentaux ». J’ai lu et relu cent fois cette pensée de Levinas. J’avais perdu mes sources, mais je m’interrogeais sur elles, donc je n’avais pas tout perdu. C’était un peu ce que racontait cette fable hassidique de Rabbi Israël de Rishin, sur l’histoire qu’on rapporte d’une vieille prière dite dans la forêt en allumant un feu, gestes rituels dont on a tout oublié, sauf précisément son histoire, l’histoire de cette déperdition générationnelle, histoire racontée qui est aussi efficace, dit le récit hassidique, que la prière elle-même, et le feu qu’on allumait, et l’endroit exact de la forêt où cela se faisait. Là, encore, pour un certain nombre d’entre nous, cette histoire, tout comme la pensée de Levinas que je cite, étaient consolatoires.
Cela correspondait-il à un réveil identitaire ?
H.R. : Oui mais pas au sens de repli ni d’assignation comme on peut l’entendre aujourd’hui. Nous avions soi-disant perdu notre identité avec le militantisme gauchiste de Mai 68 mais aussi le militantisme communiste de nos parents. J’avais longtemps cru que communiste et juif se confondaient et se superposaient. En devenant communiste, mon père pensait qu’il embrassait l’universel alors que tous ses camarades communistes de Belleville étaient juifs comme lui. Le syndicaliste Henri Krasucki, avec lequel mon père a combattu dans les rangs des FTP-MOI sous l’Occupation allemande, lui avait un jour dit qu’il pouvait le faire engager d’un claquement de doigt aux usines Renault de Billancourt avec un salaire régulier et des facilités pour monter dans la hiérarchie du Parti communiste. Mon père a décliné cette offre. Il préférait rester derrière sa machine à coudre et tant pis pour les mortes-saisons et les traites à payer ! Comme si la place d’un Juif était dans l’atelier de confection et non pas à l’usine.
Mais l’univers familial dans lequel vous avez grandi était encore très juif, c’est-à-dire ancré dans le monde d’avant la shoah. Il n’y a donc pas de perte ?
H.R. : Il n’y a pas de perte mais il y a le silence et la clandestinité de cette judéité. Nous étions juifs à la maison. Ainsi, mes parents reproduisaient inconsciemment le modèle d’identité juive qui n’était pas celui de leurs parents mais celui des Français israélites tel qu’il a été défini par les tenants de l’émancipation à la fin du 18e siècle : citoyen français dans la sphère publique et juif dans la sphère privée. Dans la cellule communiste de Belleville où mon père militait, presque tout le monde était juif polonais. Mais ils ne parlaient jamais de çà. Sauf de temps en temps, il leur arrivait d’échanger clandestinement et à voix basse quelques mots en yiddish.
Comment s’opère votre découverte de Proust ? Ou plutôt comment le petit fils d’immigrés juifs polonais de Belleville rencontre l’israélite mondain des beaux quartiers de l’Ouest parisien ?
La figure de l’israélite de la Belle-Époque n’a cessé de me fasciner. Il incarne évidemment les beaux quartiers de Paris, l’élégance et le luxe, les écoles et les lycées d’élite, les lieux de sociabilité et de villégiature où se retrouve la bonne société, etc. Ces israélites sont évidemment juifs comme moi mais ils sont tellement différents de nous, Juifs originaires de Pologne et d’Europe orientale. Ils sont à la fois dans la proximité et l’éloignement.
Mais votre passion pour Marcel Proust va bien au-delà de son appartenance au monde des israélites et du Paris huppé et grand-bourgeois ?
H.R. : Evidemment. C’est surtout le statut qu’il attribue à la mémoire qui me touche. Et plus précisément son articulation avec son contraire : l’oubli. Car l’envers de la mémoire, c’est l’oubli. Contrairement à la mémoire bergsonienne, la mémoire est involontaire chez Proust. A cause d’une sensation presque fugitive qui nous traverse, c’est par hasard que quelque chose d’oublié resurgit du passé. Comme tout mon travail d’écrivain est intimement lié à la mémoire, ce n’est donc pas par hasard que je rencontre Proust. J’ai consacré de nombreux travaux à Charles Haas, ce mondain qui a inspiré le personnage de Charles Swann dans A la recherche du temps perdu. Charles Haas a réellement existé mais il est tombé dans l’oubli et l’anonymat. Or, Proust en a fait le personnage de Swann qui est quant à lui devenu immortel. C’est ça la force extraordinaire de la littérature, du moins la littérature réussie : sauver des bribes de mémoire de l’oubli, c’est une manière de lutter contre la mort. « Un livre est un grand cimetière où sur la plupart des tombes on ne peut plus lire les noms effacés », écrivait Proust. Le nom de Swann, devenu si prestigieux grâce à Proust, recouvre celui, méconnu, inconnu, de Charles Haas, un homme célébré et adulé dans la société du Second Empire puis de la IIIe République. Et sans me comparer à Proust, à mon tour j’ai voulu « sauver des noms ». C’est la raison pour laquelle dans mon dernier livre, L’arrière-saison des lucioles, j’énumère des femmes et des hommes que j’ai croisés, morts pour la plupart, dont je peux restituer, non pas une biographie, mais des bribes de souvenirs ou de traits qui m’ont marqué. Une manière de les désanonymer.
Dans Le cygne de Proust (éd. Gallimard), non seulement vous établissez le lien entre Haas et Swann mais vous vous interrogez sur le rapport qu’entretient Proust avec sa judéité à travers ces deux hommes…
H.R. : Quand j’ai écrit Le cygne de Proust, j’ai opposé Swann, le cygne en anglais, à Haas, le lièvre en allemand. Proust a transformé Charles Haas en Charles Swann. D’un animal banal comme le lièvre, il devient un animal élégant comme le cygne. Pour bien montrer que Charles Haas, un Juif allemand originaire de Francfort, est devenu un Français de la bonne société, Proust est génialement passé par l’anglais, synonyme de noblesse et d’élégance à l’époque. En dégermanisant Haas, il s’agissait en réalité de le déjudaïser. Même si à la fin de leur vie Haas et Swann prennent les traits de prophètes juifs avec une barbe et un nez de plus en plus busqué. On peut ainsi lire : « Le nez de Polichinelle de Swann, longtemps résorbé dans un visage agréable, semblait maintenant énorme, tuméfié, cramoisi, plutôt celui d’un vieil hébreu ». Et lorsqu’on découvre des portraits de Proust à la fin de sa vie, ses traits sont identiques à la description qu’il fait de Swann. Je connais aussi un tas de Juifs au goyishe ponem qui deviennent en vieillissant des alte yidn. D’une certaine manière, ils redeviennent ce qu’ils sont.
Un écrivain juif, mais pas seulement
Bien qu’il ne supporterait pas être enfermé dans la catégorie « écrivain juif » et que pendant de nombreuses années il avait vigoureusement contesté l’idée selon laquelle il pouvait exister une littérature juive, il reconnait volontiers aujourd’hui qu’il est devenu un écrivain juif. Non seulement il a consacré de nombreux articles et dossiers à la littérature juive dans des langues non-juives dans différentes revues, dont Regards où il tient une chronique littéraire depuis 1996, mais il a lui-même participé à travers ses livres à définir les contours d’une littérature juive.
Né à Belleville en 1948, de parents juifs polonais, Henri Raczymow a grandi dans l’ombre de son oncle mort en déportation, dont on lui a donné le prénom. La Shoah et la façon dont cet événement s’est métabolisé dans les familles, dans les générations suivantes a été le principal sujet de son écriture. « Il porte le poids d’une mémoire juive et aussi le poids de l’histoire juive. Il fut un des premiers écrivains à pointer cet aspect absolument mortifère et destructeur que les psychanalystes n’ont étudié que plus tard et qu’ils vont qualifier de transmission intergénérationnelle du trauma. C’est la force de la littérature d’avoir une longueur d’avance sur la recherche scientifique », souligne Anny Dayan-Rosenman, professeur de littérature à l’Université Paris VII-Denis Diderot et spécialiste des écrivains, des psychanalystes et des philosophes qui ont étudié et questionné la shoah. « Le rapport au yiddish occupe aussi une place centrale dans l’œuvre d’Henri Raczymow. Il est également un des premiers écrivains juifs de langue française à parsemer ses textes de mots de yiddish. C’est en le lisant que j’ai appris un tas d’expressions yiddish que ma belle-mère, Juive polonaise, n’a pas réussi à m’inculquer ! ».
Toutefois, il serait erroné d’enfermer Henri Raczymow dans la case « écrivain juif ». Il est bel et bien un écrivain avec un grand « E ». Grand lecteur et un passionné de littérature, il connait bien l’œuvre de Barthes, a consacré de nombreux travaux à Flaubert et fait partie des grands spécialistes reconnus de Proust. Mais ce cher Marcel est juif, rétorqueront les esprits chagrins. En effet, et bien qu’Henri Raczymow ait notamment analysé La Recherche sous l’angle de la judéité de Proust, il ne s’est jamais limité à cette dimension. Il suffit de parcourir sa bibliographie pour le comprendre. Et son livre précédent, Une saison avec Luce (éd. Du Canoé), est un véritable roman proustien. « Un véritable bijou, une histoire d’amour à la Proust, avec des phrases plus courtes, et moins de pages. On ne sait si son héros cherche une muse pour écrire ou une femme à aimer », saluait Frédéric Beigbeder dans sa chronique littéraire du Figaro.
Si Henri Raczymow est un écrivain juif, c’est précisément parce qu’il rend compte de la richesse, de la complexité et des paradoxes de l’existence juive. Exprimant sans cesse la difficulté de s’inscrire dans une filiation juive, à intégrer un héritage symbolique et à transmettre une mémoire, son œuvre documente formidablement la manière dont les Juifs s’efforcent de trouver un équilibre précaire entre des impératifs et des aspirations souvent contradictoires. A travers la littérature, il montre ainsi que les Juifs n’avancent pas sur un chemin balisé bien tracé. Ils se démènent tant bien que mal sur une corde raide. C’est ce que Kafka, qu’affectionne d’ailleurs Henri Raczymow, décrivait avec justesse et talent : « Le vrai chemin passe par-dessus une corde qui n’est pas tendue en hauteur, mais presque au ras du sol. Elle semble plus faite pour faire trébucher que pour être franchie »[1].
[1] Franz Kafka, Réflexions sur le péché, la souffrance, l’espérance et le vrai chemin, éd. Rivages poches.