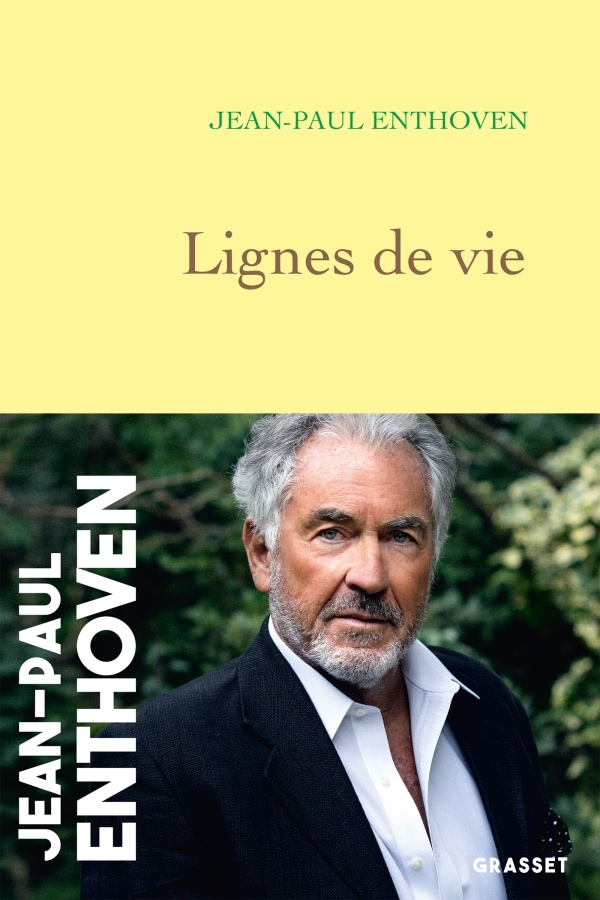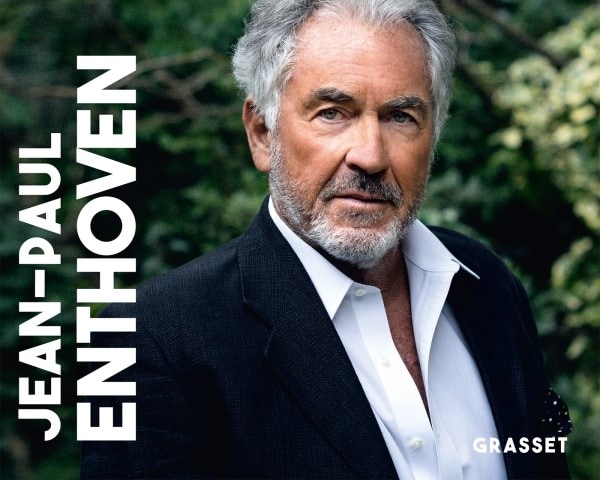Jean-Paul Enthoven, Lignes de vie, Grasset, 285 p.
Des années durant, j’ai lu ses chroniques littéraires dans le Nouvel Obs. Pour l’amoureux de la littérature que j’étais (et suis encore), c’était un enchantement. J’ai toujours lu Enthoven sous l’angle de ce que Barthes appela le plaisir du texte. L’érudition et la grâce conjuguées. Grand proustien devant l’Eternel (avec son fils Raphaël), mais pas que. Enthoven, c’est surtout le beau style, à chaque page, à chaque phrase. Elégance et dandysme, mais sans forfanterie.
Ici, il nous convie à ce qu’il appelle lui-même, et modestement, un « vrac », qui va de la bonne humeur à la mélancolie, et retour, où l’on peut voir, sinon du Proust, en tout cas du Montaigne et du Stendhal (bien plus que du Flaubert). Du côté de la liberté et de l’égotisme. On dirait qu’Enthoven vit exclusivement dans le monde enchanté de la littérature. Un peu chez les Verdurin, un peu chez les Guermantes. Chez tous les grands écrivains. Chez les aristocrates (d’Ancien Régime tant qu’à faire), pas franchement hostile à une Révolution pourvu qu’elle fût amusante et coquine.
Il n’est pas comme nous autres. Il ne se commet pas aux choses basses, trop terre-à-terre, trop proches du sol. Il ne daigne pas se baisser, ce n’est pas digne de lui et, pour respirer dans les hauteurs, inutile de se salir les mains. C’est un esprit des Lumières, un esprit supérieur, un esthète, un esprit fort, comme on n’en fait plus. Profond et léger. Ce dineur en ville invétéré adore les pessimistes qui par contraste parviennent à rehausser, comme il dit, son « goût déraisonnable du bonheur ». Mondain, amoureux de la littérature, et amoureux des femmes, surtout celles qu’on dit du monde ou mieux du grand monde. Un homme d’un autre temps en tout cas, incapable de vous dire le moindre mal de Jean-Paul Sartre. Ça ne trompe pas. Quant à juger du grand talent d’Enthoven, on lira avec ravissement les pages qu’il consacre à son unique rencontre avec Louis Aragon, « chevelure d’ange sous un large panama », la nuit de l’élection de Mitterrand à la présidence française en mai 1982. Aragon, princier et toujours stalinien, était entouré de ses jeunes adorateurs (les « libellules ») tournoyant autour de leur « Gros-Loulou » chéri rejoignant ses pénates, je veux dire son hôtel particulier rue de Varenne. Un morceau d’anthologie.