L’autobiographie que vous publiez est-elle un exercice d’égo-histoire tel que l’historien Pierre le conçoit, c’est-à-dire une tentative d’éclairer sa propre histoire comme on ferait l’histoire d’un autre, d’appliquer à soi-même le regard froid, englobant, explicatif qu’on porte sur d’autres ?
Elie Barnavi : L’exercice est voulu. C’est une manière de dialoguer avec l’Histoire et de faire de l’histoire à travers l’historien qui rédige son autobiographie. Les chapitres consacrés à ma vie en Roumanie jusqu’à mon arrivée en Israël en 1961 nous apprennent beaucoup sur la manière dont un individu a vécu le passage d’une société communiste à une société démocratique. Et les chapitres consacrés à mon implication dans la vie politique et diplomatique israélienne relèvent de l’égo-histoire même si tout cela est entremêlé de considérations purement personnelles qui n’intéressent que moi et mes amis.
Avez-vous consciemment choisi d’évoquer votre expérience militaire dans une unité de parachutistes sans vous attarder sur l’héroïsme, le courage au feu et la fraternité des armes ?
E.B. : Je nie pas l’héroïsme ni le courage des soldats de Tsahal mais je ne souhaite pas tomber dans le piège de la propagande car l’expérience militaire est un tout. Dans la vie quotidienne d’un soldat, il y a peu d’héroïsme. Ainsi, pour un soldat de la Légion étrangère française, l’épluchage de patates occupe plus de temps que les actions d’éclat qu’il pourra accomplir au combat. C’est ce que j’ai voulu montrer dans ce livre. J’étais volontaire pour servir dans les parachutistes, une unité d’élite qui a accompli des exploits importants. Mais il faut aussi avoir l’honnêteté intellectuelle de reconnaître que notre vie quotidienne était plutôt banale, routinière et parfois médiocre.
Même si vous n’avez jamais fait d’histoire militaire, votre expérience de la guerre vous a-t-elle permis de mieux comprendre comment les événements politiques se dessinent ?
E. B.: En tant que soldat, j’ai pu voir comment la guerre du Liban s’est décidée en 1982. Cela m’a permis de saisir immédiatement la singularité de cette guerre purement politique. Ariel Sharon, alors ministre de la Défende, concrétisait la vision de Clausewitz selon laquelle la guerre est la continuation de la politique par d’autres moyens. J’ai pu le comprendre en temps réels lorsque j’étais sur le front avec mon unité. L’historien que je suis avait tout de suite compris que nous étions en train de commettre une énorme connerie car ce type de guerre ne se solde jamais par une victoire. Un homme aussi brillant qu’Ariel Sharon n’a pas eu l’intelligence de lire la carte politique libanaise tellement il était emporté par son hubris et sa volonté de redessiner la géopolitique du Proche-Orient avec une fraction libanaise en pleine débandade politique et démographique.
Dans ce livre, on découvre que vous avez suivi la fin de votre scolarité dans une institution catholique française de jaffa, le Collège saint-Joseph. Cette expérience est-elle la source de votre passion pour l’Europe et la France en particulier ?
E. B. : Mon passage chez les Frères des écoles chrétiennes a déterminé mon destin intellectuel. Et ironie du sort, j’ai atterri dans ce collège catholique de Jaffa parce que la directrice du lycée que je fréquentais à Beer-Shev’a avait expliqué à mon oncle venu s’enquérir de mes performances scolaires que j’étais « un bon à rien ». Elle ajouta qu’il « faudra lui dénicher une institution à poigne, sinon ça finira mal pour lui » ! C’est ainsi que mon oncle Avi m’a inscrit au Collège Saint-Joseph de Jaffa. Rien ne me prédestinait à fréquenter cette institution catholique française aussi excentrée de l’expérience collective israélienne. Mais mes années au Collège saint-Joseph ont déterminé mon avenir intellectuel et professionnel. Si j’ai étudié l’histoire de France, poursuivi mon cursus universitaire à Paris, écrit en français et fini par devenir ambassadeur d’Israël à Paris, c’est la conséquence de mon passage dans cette école. Cette manière de vivre et d’évoluer dans deux univers très différents, une société juive israélienne et un îlot français catholique, m’ont été profitable même si ce n’était pas toujours facile à gérer.
Vous avez passé plusieurs années en France et Belgique où vous êtes comme chez vous. Pourquoi ne pas avoir franchi le pas en vous installant définitivement Europe ?
E. B. : Pas un seul instant je n’y ai songé. Pour des raisons idéologiques, je suis convaincu qu’il faut être de quelque part. J’ai besoin d’appartenir à un collectif national et politique dont je suis membre à part entière. Et le seul endroit au monde auquel j’appartiens véritablement c’est Israël. Je me fais peut-être une idée naïvement trop haute de la citoyenneté mais c’est aussi la raison pour laquelle je n’ai jamais accepté de passeport étranger. Quand j’ai passé trois ans à Paris dans le cadre de mon cursus universitaire, j’aurais pu obtenir la nationalité française en me rendant à la préfecture parce que ma première femme était française. Lorsque la France a imposé des visas aux ressortissants non-européens suite à la vague d’attentats en 2015, le consul général de France
m’a proposé de m’accorder un passeport français, ce que j’ai à nouveau refusé. Le passeport est davantage qu’un petit document administratif. Il a une dimension identitaire forte. Je n’ignore pas que nombre de mes compatriotes sont prêts à tout pour obtenir un passeport polonais, hongrois, roumain, autrichien ou allemand. Il n’y a pas de mal à cela mais c’est historiquement indécent et esthétiquement déplaisant.
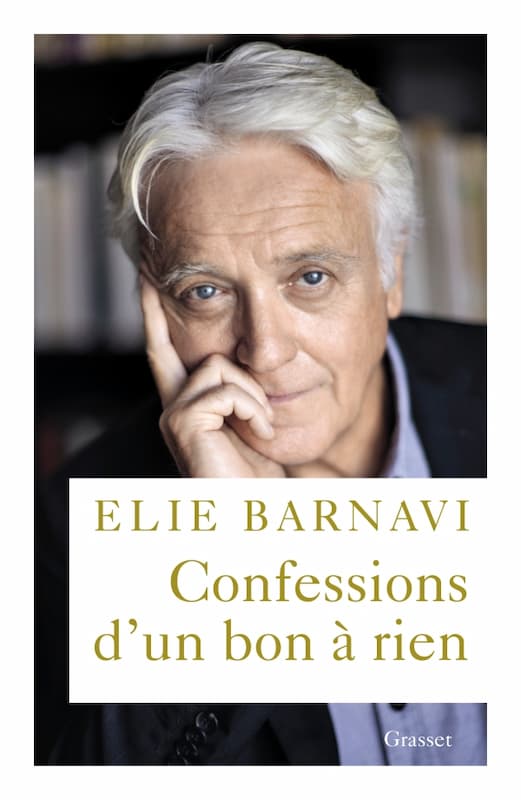
Etes-vous donc à la fois sioniste et cosmopolite ?
E. B. : Dans une citation restée célèbre, Jean Jaurès liait l’internationalisme au patriotisme lorsqu’il déclarait : « Un peu d’internationalisme éloigne de la patrie ; beaucoup d’internationalisme y ramène. Un peu de patriotisme éloigne de l’Internationale ; beaucoup de patriotisme y ramène ». Le sionisme est mon patriotisme. Il est le nom du mouvement national juif qui a concrétisé son projet : créer un Etat-nation pour le peuple juif sur la terre de ses ancêtres. Une fois la création d’Israël accomplie en 1948, le sionisme est devenu un slogan creux réduit à des appareils et des bureaucrates qui s’agitent au nom de ce slogan creux. Pourtant, je demeure sioniste car je crois profondément en la justesse morale et la nécessité historique d’un Etat juif. Je me considère même comme un Juif national, c’est-à-dire que je ne suis juif que par Israël. Ce qui ne m’empêche pas d’être sincèrement cosmopolite : je suis un citoyen du monde capable d’être bien ailleurs qu’en Israël. Quand je me rends à Paris ou à Bruxelles, je me sens chez moi et je ne vois aucune contradiction entre ce cosmopolitisme et mon sionisme.
Vous montrez bien que jusqu’à la fin des années 1970 Israël avait les allures d’une démocratie populaire. Quelles en étaient les signes ?
E.B. : On oublie souvent qu’Israël a longtemps gardé l’allure austère et empesée d’une démocratie populaire d’Europe de l’Est, les libertés en sus. La société était corsetée dans une idéologie égalitaire héritée de la période de gestation de l’Etat. L’économie était encore largement étatisée, les salaires maigres, les taxes frappaient les produits dits de luxe, les voitures surtout, prohibitives. L’argent, quand il existait, se cachait. Etre riche n’était pas bien vu. C’était une société conformiste, faussement frondeuse, très patriotique et fortement unie autour de ses dirigeants. En contrepartie, c’était une société étonnamment égalitaire et solidaire où les gens protégeaient les enfants des autres comme les leurs propres, et où l’on se précipitait pour vous donner un coup de main si l’on vous voyait en difficulté.
Tout a changé avec l’arrivée au pouvoir de la droite nationaliste de Begin en 1977. Le changement fut-il brutal ?
E. B. : Le changement ne fut pas brutal mais ses expressions le furent. Dans son attelage, la droite nationaliste de Begin était accompagnée de la droite libérale. Comme Begin ne se préoccupait pas des questions économiques, il a laissé les ministres libéraux remettre les pendules à l’heure en faisant entrer Israël, non pas dans l’ère libérale, mais ultra-libérale. L’économiste américain libéral Milton Friedman s’est rendu en Israël tout content de trouver un autre client que le Chili de Pinochet. Il ne comprenait pas ce qui était arrivé au peuple juif en Israël, lui qui affirmait que les Juifs ont toujours su tromper l’Etat ! Friedman oubliait une chose essentielle : en Israël, l’Etat, c’est les Juifs. Depuis lors, l’économie s’est privatisée à une allure incroyable et les riches se sont décomplexés. Le nouveau riche est devenu un type social en Israël. La phase collectiviste héroïque était à bout de souffle. Il fallait injecter une dose de libéralisme mais pas avec les excès que nous avons connus. Si bien que nous sommes passés en l’espace d’une génération d’une société des plus égalitaires à la société la plus inégalitaire de l’OCDE après les Etats-Unis. Tel-Aviv est même devenu aujourd’hui la ville la plus chère au monde selon certains organismes économiques. Il ne reste donc plus rien de cette « démocratie populaire » juive.
Dans cette autobiographie, vous précisez vos convictions politiques social-démocrate et vous insistez sur le lien entre politique et démocratie. La politique ne se conçoit qu’en démocratie ?
E. B. : Cela ne se dit pas suffisamment mais la politique n’est concevable que dans un régime démocratique. Ce n’est pas un hasard si la politique est née en même temps que la démocratie athénienne. Mon idéal politique est de se passer d’idéal politique. Je me méfie comme d’une peste de l’utopie, cette grande pourvoyeuse de goulags, je ne veux pas d’homme « nouveau », rééduqué à coups de slogans et forcé à marcher au pas cadence vers la société parfaite qu’on a imaginée pour lui. Je ne désire ni perfection sociale ni pureté révolutionnaire d’aucune sorte. La bonne société à laquelle j’aspire est imparfaite, car nous sommes des êtres imparfaits, mais perfectible, puisque nous sommes des êtres doués de raison et capables d’empathie. J’ai compris avant de faire de Tocqueville l’un de mes auteurs de chevet, que les deux grands principes au cœur de la démocratie moderne, l’égalité et la liberté, sont tout bonnement contradictoires – vous voulez l’égalité absolue, vous n’aurez pas de liberté (ni, d’ailleurs, l’égalité), vous aspirez à la liberté sans entrave, alors oubliez l’égalité, et même la liberté (sinon celle du loup dans la bergerie). Oui, je suis social-démocrate. Un système qui accorde du mieux qu’il peut, par hypothèse imparfaitement, ces deux exigences contradictoires de l’égalité et de la liberté. Pas toute l’égalité, ni toute la liberté, mais le plus possible d’égalité et de liberté, ensemble. Ce n’est pas exaltant, ça ne promet pas des lendemains qui chantent, ni même la lune, mais c’est faisable et surtout, ça respecte mon principe primordial : primum non nocere (D’abord, ne pas faire de mal).
Les pères fondateurs d’Israël ont-ils satisfait les exigences démocratiques ?
E. B. : Les pères fondateurs travaillistes d’Israël n’étaient pas des démocrates dans l’âme mais ils ont compris que la démocratie libérale était le seul régime acceptable pour Israël, tant par souci d’efficacité que pour trouver une place dans le monde pour Israël. David Ben Gourion, un des grands fauves politiques de ce siècle, le seul qu’Israël ait jamais eu et dont l’instinct n’était pas libéral, a malgré tout construit un régime démocratique. Ce résultat est merveilleux car il est sans exemple qu’un Etat neuf issu d’une tragédie comme la Shoah, en état de guerre permanent, exposé à des menaces existentielles et faisant face à une immigration massive de populations très diverses réussisse à accoucher d’un cadre démocratique viable et solide. C’est un cas unique dans les annales de l’Histoire.
Et la droite nationaliste a-t-elle respecté le cahier de charges démocratique ?
E. B. : Pour des gens de gauche comme moi, Menahem Begin était l’incarnation du fascisme. Nous pensions sincèrement que s’il arrivait au pouvoir, c’en était fini pour la démocratie israélienne. Evidemment, nous avions tort sur toute la ligne. De ce point de vue, ce fut un immense soulagement. Même s’il fut un terrible démagogue dressant les Juifs du Maghreb et d’Orient contre les Ashkénazes, il a respecté scrupuleusement l’Etat de droit et a toujours manifesté un attachement sans faille à la démocratie libérale. Même son successeur Yitzhak Shamir n’a jamais remis en cause notre régime démocratique. Pourtant, il y avait un prurit de fascisme évident chez cet idéologue d’extrême droite qui pouvait parler de la guerre comme d’un idéal à maintenir. Mais comme Begin, il respectait l’Etat de droit et était d’une probité sans faille.
On ne peut pas en dire autant de leur héritier Benjamin Netanyahou…
E. B. : Netanyahou est un personnage luciférien. Innocent de toute morale, il est le malheur d’Israël. Il a tout fait pour enterrer Oslo et il a réussi. Et sur le plan intérieur, il a affaibli les institutions démocratiques en s’attaquant à la justice, à la presse et au tissu associatif. Il a exacerbé la polarisation de la société israélienne et a transformé le Likoud en un parti expurgé de tous ses éléments modérés, démocrates et respectueux de l’Etat de droit. Si Menahem Begin ressuscitait et revenait au Likoud, il ne trouverait pas de place dans ce parti qu’il a créé. Car pour le Likoud de Netanyahou, la démocratie n’est pas une option préférable.
——
Entre Chateaubriand et Scholem
Comme Chateaubriand dans ses Mémoires d’outre-tombe, Elie Barnavi traite d’événements politiques et historiques dont il fut un témoin privilégié tout en dévoilant avec pudeur de nombreux fragments de son existence. Et comme le plus célèbre des écrivains-diplomates français, il consigne ses souvenirs dans une prose élégante qu’il agrémente parfois d’anecdotes croustillantes (la complicité gastronomique et gargantuesque entre Jacques Chirac et Ariel Sharon), de confidences et de détails éclairants sur les qualités et les défauts de certaines personnalités politiques (le Roi Philippe -alors prince héritier- demandant à Elie Barnavi pourquoi les intervenants juifs dans un débat lors d’une conférence Bilderberg ne sont pas d’accord entre eux !).
Ses confessions se lisent aussi comme De Berlin à Jérusalem de Gershom Scholem. A l’instar de ce grand spécialiste de la mystique juive, Elie Barnavi revient sur ses origines, sa famille et son enfance en Europe orientale mais aussi sa nouvelle vie en Israël. Dans des passages où les faits abondent, il narre ses rencontres avec de grandes pointures des mondes académiques et intellectuels israéliens et français dont certains ont été de grands esprits de l’époque. Et en retraçant comme Scholem son itinéraire de Juif qui le mène de l’Europe en Israël, il nous propose une réflexion stimulante sur l’identité juive et israélienne au 20e siècle.










Quand je lis cette interview et plus particulièrement la réponse à la dernière question, je me dis, en paraphrasant un brillant humoriste, que Monsieur Barnavi est capable du meilleur comme du pire mais que dans le pire, il est le meilleur.