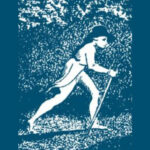Depuis le 7 mai 2024, une centaine d’étudiants et de militants occupent le Bâtiment B du campus du Solbosch de l’Université libre de Bruxelles (ULB). Dans leur communiqué de l’Université populaire, ils entendent dénoncer le « génocide en cours à Gaza » et exigent que « l’ULB rompe immédiatement et sans équivoque toutes formes de collaboration avec les institutions académiques et les entreprises sionistes qui participent à l’oppression systématique du peuple palestinien en Palestine ». Ils expliquent également qu’ils se « joignent à l’appel d’une université populaire et décoloniale, où tou·te·s auront accès au savoir, à la discussion ainsi qu’à l’autogestion. Non pas un accès à un savoir dédié à dominer, oppresser, surveiller, coloniser et massacrer les populations du monde, mais un endroit d’éducation populaire. » Et enfin, ils « exigent l’annulation immédiate de la venue de l’ancien ambassadeur de l’entité coloniale israélienne, prévue lors de la conférence du 3 juin, en affirmant leur opposition inébranlable face à toute forme de normalisation et des relations avec des représentants de cet État. » Ils visent ici Élie Barnavi, historien et par ailleurs membre de la rédaction de Regards.
Cette occupation du Bâtiment B n’est pas un vibrant plaidoyer pour la liberté d’expression, mais plutôt une démonstration de l’incapacité de militants enragés à engager un discours constructif avec les voix juives et pro-israéliennes sur le campus. Ils ont au contraire embrassé et amplifié une attitude de refus du dialogue, considérant ce refus comme une vertu. Dès le premier jour de leur occupation de ce bâtiment, des heurts sont survenus. « Nous nous tenions devant ce bâtiment occupé, lorsqu’on a demandé aux journalistes sur place de nous laisser nous exprimer. Dès que l’interview a commencé, une centaine d’étudiants nous a crié “Sionistes ! Fascistes ! Terroristes !”. La journaliste sur place a été agressée verbalement pour avoir “osé nous donner la parole” alors même que nous faisions passer un message de paix, d’apaisement et d’ouverture », se souviennent Gabrielle Piorka et Gad Deshayes, coprésidents de l’Union des étudiants juifs de Belgique (UEJB). Et quelques heures plus tard, la violence verbale et les intimidations ont dégénéré en agression physique lorsque Gad Deshayes a été roué de coups par des occupants alors qu’il marchait sur le parking situé à quelques centaines de mètres du bâtiment occupé. « J’ai été agressé. Je ne portais sur moi aucun signe ni de drapeau israélien, je me tenais juste là, sur mon campus », raconte Gad Deshayes. « Cette personne m’a simplement reconnu et me l’a fait savoir en me disant : ‘‘Je te reconnais, tu es le président de l’UEJB’’, avant de me sauter dessus pour me frapper. Un de ses amis lui a dit d’arrêter, il a répondu ‘‘Non c’est un sale Juif, il faut le frapper’’. Par chance, la sécurité est intervenue. Des étudiants juifs ont été agressé verbalement dans l’auditoire occupé, ils ont été éjectés de l’auditoire sous les cris “l’UEJB est là, il faut les faire sortir”. »
Déploiement scénique conscient
Bien que ces occupants ne prônent pas le dialogue et aient fait d’emblée le choix de l’intimidation et de la violence, certains observateurs mal inspirés ont comparé cette mobilisation étudiante, qui se répand aujourd’hui dans de nombreuses universités occidentales, aux grands mouvements de contestation qui ont marqué ces établissements à la fin des années 1960. Ainsi, une éditorialiste du Soir parlait de « La saine rébellion des étudiants américains » et le Premier ministre belge, Alexander De Croo, n’a pas hésité à déclarer que cette contestation est compréhensible : « Si j’avais leur âge, je serais probablement avec eux. C’est normal qu’il y ait une voix de protestation et une demande de dialogue dans un conflit complexe qui montre une incapacité au niveau internationale de l’arrêter. » De leur côté, les étudiants et les militants présents dans ces mobilisations dénonçant le « génocide à Gaza » se considèrent comme les héritiers des mouvements héroïques de contestation contre la guerre du Vietnam ou des manifestations étudiantes de Mai 68. « Ce sont des situations très différentes d’aujourd’hui », confirme Eva Illouz, sociologue franco-israélienne, directrice d’études à l’École des hautes études en sciences sociales (EHSS) et également professeur invité à l’Université de Princeton, sur les ondes de France Culture. « Ils ont étudié les manifestations de 1968 pour les répéter aujourd’hui. Il y a une sorte de déploiement scénique conscient pour invoquer cet imaginaire révolutionnaire de la fin des années 1960. Mais il s’agit d’une forme de répétition calculée d’actes véritablement spontanés et révolutionnaires en 1968. Par ailleurs, en 1968, les étudiants se révoltaient contre des autorités universitaires conservatrices ou même franchement réactionnaires. Or, aujourd’hui, les universités ont énormément changé. Elles déploient un nombre incroyable de ressources pour protéger les minorités du racisme, du sexisme, de l’homophobie et la transphobie. Elles ont complétement intégré les valeurs progressistes. Si bien que les universités ne représentent pas les dominants comme dans les années 1960. » Il convient même d’ajouter que les mouvements de contestation des années 1960 se voulaient clairement pacifiques. La violence était souvent la réaction des forces de l’ordre. Les témoins de l’époque se souviennent surtout d’un grand moment de libération de la parole, d’un moment où l’on se parlait. Il se manifestait aussi un désir de liberté dans une société rigide qui n’avait pas préparé l’arrivée à l’université des enfants du baby-boom de l’après-guerre. Ils entendaient surtout bousculer les cloisons d’une société patriarcale encore très rigide.
Si les universités ont un mérite, c’est bien celui de garantir la confrontation des idées, en particulier dans une université comme l’ULB dont le libre examen est la marque de fabrique. Or, dans cette occupation du Bâtiment B (comme ailleurs), les concepts d’« anticolonialisme » et d’« accès au savoir » promus par cette Université populaire ne constituent en aucun cas les fondements d’une connaissance plus profonde des problématiques réelles. Au contraire, ils sont utilisés comme autant de prétextes pour entretenir l’ignorance et le fanatisme.
La tendance émergente dans le monde universitaire est de considérer l’État juif comme la dernière création coloniale de l’Europe blanche. Israël doit être exécré au même titre que l’Afrique du Sud sous l’apartheid, la Rhodésie et même l’Allemagne nazie. Ce faisant, la nécessité de comprendre l’histoire particulière des Juifs, la Shoah et la crise des réfugiés qui s’en est suivie, ainsi que la mosaïque de la société juive contemporaine en Israël, est balayée d’un revers de main. Comme s’ils avaient rejeté l’utilisation du terme « complexité », car il servirait d’écran de fumée pour masquer les méfaits de l’État d’Israël. Cette capacité de transformer l’ignorance en vertu, que l’historien américain de la littérature et critique littéraire Harold Bloom avait qualifié dans son livre The Western Canon: The Books and School of the Ages. Editions Harcourt Brace, 1994., d’école du ressentiment, caractérise cette mobilisation étudiante pro-palestinienne à l’œuvre depuis le 7 octobre.
Combat mené contre une minorité menacée
L’actuel militantisme surjoué des manifestants pro-palestiniens dans les universités occidentales et l’analogie des plus douteuses faite avec les combats émancipateurs des années 1960 seraient sans grande importance et feraient même sourire si la mobilisation de ces manifestants et leurs modes d’action ne débouchaient pas sur des discours haineux et des actes de violence envers des étudiants juifs. Une atmosphère de haine se dégage de ces occupations de locaux universitaires et une tension insupportable pèse sur les étudiants juifs, de plus en plus isolés. « Il s’agit désormais d’un conflit entre tous les groupes qui soutiennent la Palestine et les étudiants juifs sionistes qui se sentent menacés », constate Eva Illouz. « De nombreux slogans scandés soutiennent explicitement le Hamas et en appellent sans cesse à la destruction du seul État juif dans le monde. C’est donc autant un combat contre les autorités académiques qu’un combat mené contre une autre minorité qui se sent menacée. C’est une nouveauté qui doit être soulignée. » Cette manifestation serait-elle l’incarnation de la condition juive ancestrale ? Une minorité vulnérable et isolée se tient-elle sous une très mince protection policière, tandis qu’une foule violente l’accuse d’appartenir à un peuple génocidaire devant des témoins qui poursuivent leur chemin ? Les générations de petits-enfants et d’arrière-petits-enfants de survivants de la Shoah devront-elles se résigner à l’idée que l’après-guerre paisible a été une parenthèse durant laquelle l’existence juive n’était pas contestée ?
Face à ce climat hostile aux étudiants juifs, il y a clairement une faillite des autorités universitaires occidentales. Si elles ne font pas face à leurs responsabilités, les étudiants juifs se heurteront à d’autres problèmes qui risquent de rendre leur présence compromise sur de nombreux campus. Une université ne peut se targuer d’être championne toute catégorie de l’ouverture, de la diversité et de l’inclusivité si elle fait l’économie d’une minorité juive qui a de bonnes raisons de craindre de se promener sur son campus. Bien sûr, ces problèmes sont causés par une minorité d’excités, mais comme le faisait remarquer un de nos bons amis israéliens, les minorités agissantes font souvent l’Histoire.