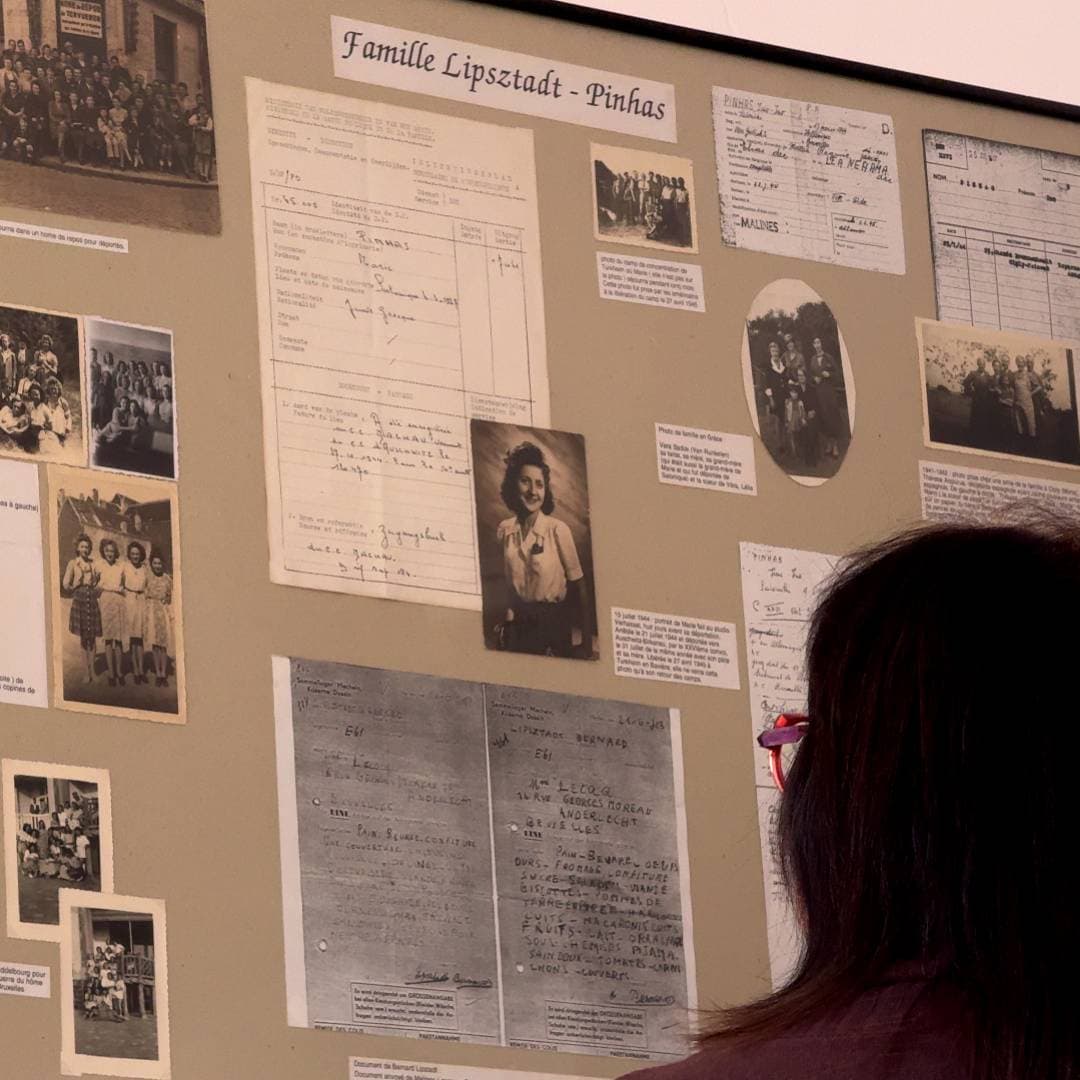« Nous sommes comme une famille maintenant ». Sur son lit d’hôpital où elle vient de subir une greffe de rein, Randa Aweis, une Arabe israélienne de 58 ans originaire de Jérusalem, parle de son donneur. Il s’appelait Yigal Yehoshua, avait deux ans de moins qu’elle, et était père de deux enfants. Il est mort le 17 mai à Lod, assassiné à coup de pierres par des émeutiers arabes parce que Juif. Son lynchage a provoqué une onde de choc dans une société israélienne fracturée et meurtrie. Mais son geste ultime symbolise aussi tout ce qu’elle peut offrir de meilleur : en faisant don de ses organes, Yehoshua a sauvé Randa, la chrétienne, ainsi qu’un jeune homme juif, Itsik, grâce à des opérations conduites par deux médecins musulmans de l’hôpital Hadassah Ein Karem de Jérusalem, Ashram Imam et Abed Halaila. Comme un défi lancé aux haineux, un encouragement à croire encore à la coexistence heureuse. Envers et contre tout ?
« al-Aqsa en danger »
Yehoshua est la deuxième victime des violences qui ont éclaté mi-mai dans plusieurs villes mixtes israéliennes (Lod, Ramle, Jaffa, Saint-Jean-d’Acre, Haïfa…) au moment où le Hamas déclenchait son opération contre Israël. Avant lui, toujours à Lod, Moussa Hassouna, un père de famille de 29 ans, avait été abattu d’une balle dans la tête par un groupe de Juifs. Son portrait placardé sur les murs de son quartier le présente désormais comme un « martyr d’al Aqsa ». Jamais Israël n’avait connu pareil chaos depuis les émeutes d’octobre 2000, pendant lesquelles 13 Arabes israéliens avaient été tués dans des affrontements avec la police. Signe funeste, ces émeutes avaient marqué le début de la Seconde Intifada. Et c’est bien le spectre d’un nouveau soulèvement qui était dans tous les esprits en découvrant avec horreur les scènes de lynchages. Aujourd’hui comme hier, il y a un catalyseur : Jérusalem, avec en son cœur la mosquée al-Aqsa, troisième lieu saint de l’Islam. De la visite d’Ariel Sharon sur l’esplanade des mosquées/le mont du Temple pour les Juifs, en 2000, à l’installation de portiques de sécurité en 2017, la moindre intervention extérieure est dénoncée comme une provocation par les Palestiniens aux cris d’« al-Aqsa en danger ». Répétant les mêmes erreurs, la police, dont il faut questionner la responsabilité [voir encadré] a cru bon cette année, au premier jour du Ramadan qui était aussi la première grande fête post-COVID des Arabes israéliens, d’installer des barrières métalliques à la Porte de Damas, d’où les fidèles se rendent à al-Aqsa. Alors que la poudrière de Jérusalem n’a besoin que d’une petite étincelle pour s’enflammer, les événements se sont entrechoqués (expulsion de familles palestiniennes à Sheikh Jarrah, défilé de Yom Yeroushalayim) jusqu’à déclencher un chaos dans la Ville sainte, qui a rouvert le front de Gaza et s’est propagé dans des villes mixtes judéo-arabes.
Plus d’intégration
Si le « syndrome de Jérusalem » est connu, le fait qu’il ait atteint les Arabes israéliens avec une telle débauche de violence interroge. Comment Israël a-t-il pu en arriver là ? D’autant que ces derniers mois, une relation nouvelle s’était établie entre les Juifs et les Arabes, qui représentent 21% de la population. La lutte contre le coronavirus, parce qu’elle n’était pas un énième conflit sécuritaire mais une crise sanitaire les obligeant à combattre côte à côte le même ennemi, les avait rapprochés. D’un côté elle a donné une visibilité nouvelle aux citoyens arabes, véritables piliers du secteur médical ; de l’autre elle a montré les services de l’Etat juif sous un jour non plus répressif, mais solidaire. L’« israélisation » de ces « Palestiniens d’Israël », comme ils se présentent parfois, se renforçait tandis que leur « palestinisation » marquait un recul avec une identification moindre au combat de leurs frères palestiniens, lui-même en sommeil. Preuve en est que la question de la Palestine n’a jamais été abordée pendant la campagne électorale. Ni par la Liste arabe unie représentant divers courants (nationalistes, laïcs, communistes), ni par le parti islamiste Raam de Mansour Abbas qui s’en était séparé, ce que chacun a compris comme un signe de maturité politique.
Et lorsqu’Abbas, faiseur de roi de ces élections, a ouvert en direct le JT de 20h des chaînes israéliennes par un discours en hébreu – une première – pas une seule fois il n’a prononcé le mot « Palestine ». Les revendications tournaient autour de la loi Etat-nation du peuple juif, non pour l’abroger mais juste l’amender en y incluant les droits des minorités. Tous réclamaient plus d’aide, plus de budget, plus de sécurité, plus de policiers. Bref, plus d’intégration. Derrière cet apparent paradoxe d’une société mieux intégrée cédant à la violence, une réalité : les Arabes israéliens, même en accédant à la classe moyenne, continuent de souffrir de multiples discriminations économiques et sociales. Eux qui payent les mêmes impôts que les Juifs israéliens, ont les mêmes devoirs (y compris le service militaire pour les Druzes et les Bédouins), ne bénéficient pas des mêmes droits. Déjà discriminés à l’embauche, ils ont des salaires moins élevés et ont été deux fois plus nombreux à perdre leur emploi durant la pandémie (8%). De plus, alors qu’aucun quartier arabe n’a été construit depuis 1948, l’accès au logement est semé d’embuches. Dans certaines villes, les Arabes se sentent abandonnés comme des citoyens de seconde zone ; dans d’autres, rabaissés par l’arrivée d’habitants tout aussi déclassés qu’eux (Juifs éthiopiens, russes) ; et dans certaines enfin, comme à Lod, menacés par l’afflux de Juifs venus du Gush Katif pour « judaïser » les villes mixtes.
Violence inouïe
La colère couvait depuis trop longtemps dans la société arabe, une communauté déjà gangrénée par la violence, les gangs, les crimes d’honneur. Alors qu’ils représentent 21% de la population, les Arabes sont responsables des 93% des crimes de sang. Selon de rares statistiques publiées en 2019 par la police, ils disposeraient de 400.000 armes, soit dérobées à Tsahal, soit acquises en Cisjordanie, soit confectionnées de manière artisanale. Depuis 2000, 1.400 Arabes ont été assassinés, souvent dans des règlements de compte entre gangs. Une violence inouïe qui a fini par tout dynamiter et sortir de la communauté. Reste que ce ne sont pas les services de l’Etat juif qui ont été pris pour cible, mais des Juifs. Ce ne sont pas des bibliothèques, des casernes de pompiers ou des écoles qui ont été caillassées comme on peut le voir à l’étranger, mais des synagogues, des lieux de coexistence, des domiciles de familles juives incendiés. De véritables « pogroms », s’est ému le président Reuven Rivlin.
A ces actes de haine pure se sont ajoutées les ratonnades organisées par des suprémacistes juifs, les hooligans de La Familia et autres extrémistes de Lehava, dont les discours racistes ont été légitimés depuis que Benjamin Netanyahou a fait entrer l’extrême-droite à la Knesset. Est-ce pour autant « le début d’une guerre civile » comme a alerté le maire de Lod, Yaïr Revivo ? Israël n’y a pas encore sombré. Les appels au calme des leaders arabes et juifs ont été pour l’instant entendus et des chaînes de la paix et autres initiatives solidaires ont fleuri partout en Israël. Mais une brèche s’est ouverte, béante, sur les non-dits de la société israélienne, qu’il faudra consolider. Cela prendra du temps. Et il en faudra du courage pour honorer la mémoire des morts et ne pas faire mentir les vivants, ceux qui continuent d’espérer et œuvrent, chaque jour, à la coexistence pacifique.
Interrogations sur le rôle de la police
Où était la police quand les villes mixtes d’Israël sombraient dans des nuits de lynchages et de ratonnades ? Prise de court par l’irruption de violences, débordée par l’embrasement simultané de plusieurs villes du pays, elle a dû être épaulée par la police des frontières, déployée depuis la Cisjordanie. Un temps, le ministre de la Défense Benny Gantz a même songé à faire intervenir des militaires avant d’y renoncer : non seulement leur présence était requise sur d’autres terrains, mais leurs règles d’engagement auraient sans doute envenimé la situation. Les forces de police ont réussi à ramener le calme, au prix de plusieurs nuits d’affrontements et d’un couvre-feu à Lod ; du jamais vu depuis la fin de l’Administration militaire sur les Arabes israéliens en 1966. Les « terroristes des deux camps » seront traduits en justice, a promis le nouveau chef de la police Kobi Shabtai, suscitant l’ire de son ministre de tutelle, le très droitier Amir Ohana. Près de 1.500 personnes ont été interpellées durant les émeutes, parmi lesquelles une écrasante majorité d’Arabes israéliens. Mais plus encore, où était la police pour protéger la population, prévenir ces émeutes, débarrasser la communauté arabe de ses armes ? Critiquée pour sa brutalité à Jérusalem ou son laxisme dans le drame du mont Meron, dépourvue de moyens, son rôle pose question. Un dysfonctionnement de l’Etat dû en grande partie à la crise politique qui paralyse Israël, toujours sans budget et resté deux ans sans chef de la police.