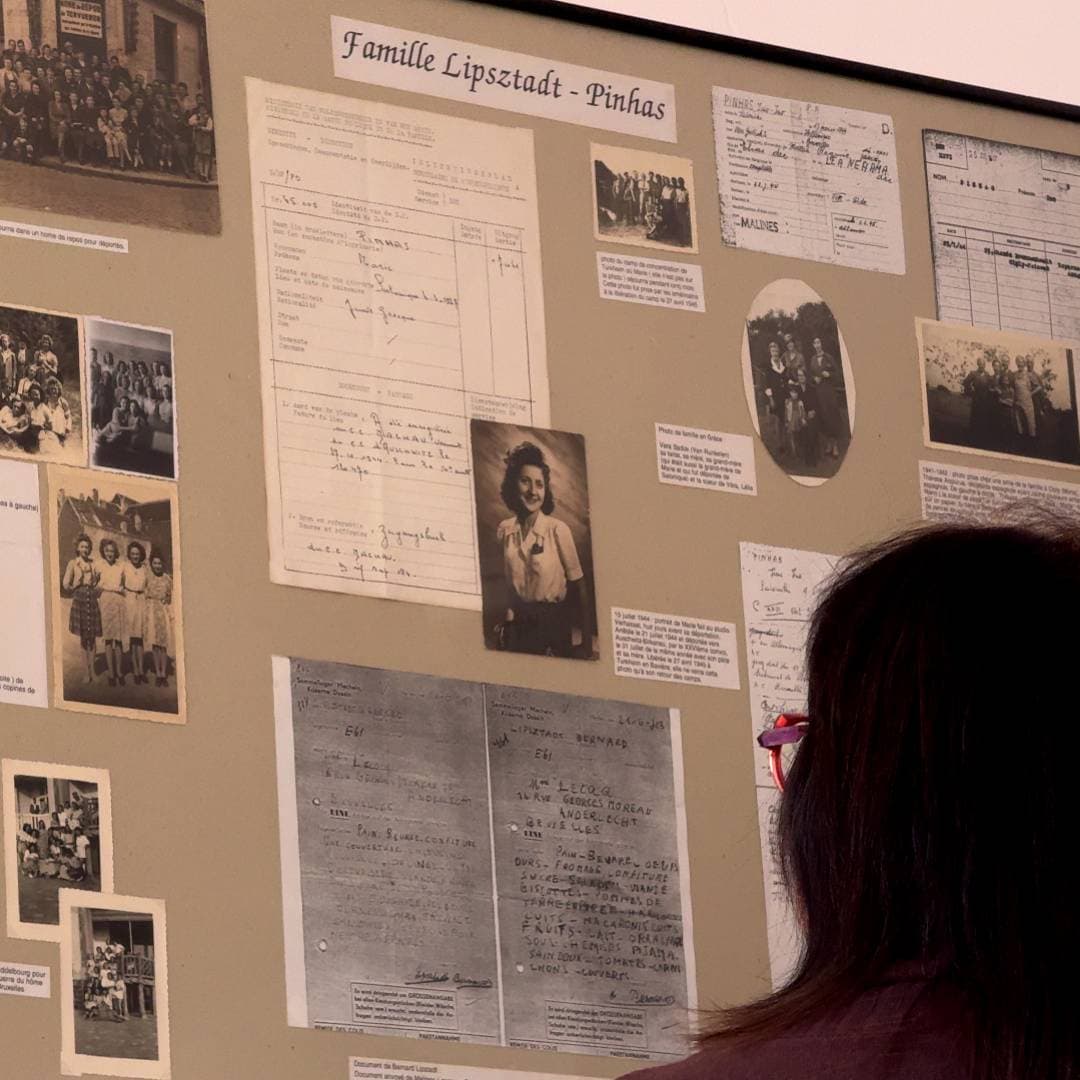Revigorée par la visite à Paris de l’ancien leader travailliste britannique Jeremy Corbyn, une partie de la NUPES a fait entrer son obsession antisioniste dans l’hémicycle et utilise le conflit israélo-palestinien pour se faire entendre.
Rive gauche, face à l’obélisque de la Concorde. Le Palais Bourbon, siège de l’Assemblée nationale, s’élève en toute majesté et inspire le respect. Sous ses colonnes, les grandes heures du débat républicain s’y déroulent depuis 1795, faisant se succéder périodes de calme relatif et débats houleux, échanges de haute volées et discordes au ras des pâquerettes. Or, cela faisait cinq années que l’opinion s’était habituée à une chambre devenue tranquille. Bien sûr, il y avait quelques coups d’éclats épars mais rien qui ne fut alors susceptible de troubler les débats dans une assemblée dominée de la tête et des épaules par le courant macroniste et ses alliés centristes. Le Président de la République « tenait » alors sa majorité. A tel point que l’on accusait les députés marcheurs d’être « godillots », c’est-à-dire dociles et aux ordres, sans libre arbitre, le tout faisant de l’Assemblée une simple chambre d’enregistrement et de validation de la politique gouvernementale.
Il ne fallut alors que quelques mois pour que la fronde s’organise hors les murs. Violemment souvent. Comme l’explique le philosophe et essayiste Gaspard Koenig, « Quand un homme, à savoir Emmanuel Macron, concentre à ce point le pouvoir, la seule manière de se faire entendre est d’aller dans la rue. Et on l’a vu durant le premier quinquennat, les tensions se sont exprimées de manière très anarchique ». Passée la longue, très longue crise des Gilets jaunes, il était clair que le pouvoir en place, en dépit de sa réélection, allait subir les assauts de toutes les oppositions. Et dans cette configuration de contestation incessante, c’est bien l’Assemblée nationale qui fait office de première barricade pour les insurgés d’où qu’ils viennent. Sans majorité nette capable de voter les textes voulus par le gouvernement, on se retrouve ainsi avec un désordre rarement vu au Palais Bourbon sous la Ve République. Au programme : brouhaha, chahut, invectives et opposition sur n’importe quel texte, du plus capital au plus anecdotique. En bon adepte du laisser-faire, Koenig pourtant y voit un mal pour un bien, le signe d’une vitalité démocratique retrouvée dans un pays qui n’aime rien tant que le débat poussé à son paroxysme : « Avec ce résultat, tout rentre dans l’ordre : le parlement va redevenir le lieu de la discussion. Les gens vont s’y sentir représentés. Ça va être le bazar dans l’enceinte du parlement, mais pas dans le pays lui-même ».
Retour du désordre parlementaire
Cette propension au chahut dans l’Hémicycle, les Français la connaissent bien. Avant 1958, l’instabilité politique constituait une donnée essentielle donnant son tempo aux institutions. Troisième et Quatrième Républiques coïncidaient ainsi avec un remue-ménage constant. Entre 1871 et 1940, 104 gouvernements différents se succédèrent puis 24, dans l’après-guerre, sous la 4e, soit de 1947 à 1958. Une instabilité qui s’explique d’abord et surtout par la prédominance du Parlement dans le système institutionnel des périodes précitées. Le résultat était alors net : il conduisait à de longues et paralysantes crises ministérielles favorisées en outre, sous la IVe République, par le mode de scrutin proportionnel, qui contribue à l’émiettement de la représentation politique et l’absence de majorités politiques stables. C’est au retour de cette configuration que rêvent aujourd’hui bien des parlementaires de l’opposition, Nupes, LR et RN réunis. Eux qui promettaient, de concert avec la majorité macroniste, d’œuvrer dans la concorde, de chercher le compromis et de se caler sur l’éthique allemande du débat calme et mesuré se sont rapidement roulés dans la fange. Pour Koenig, il faut un sursaut, une méthode nouvelle. « C’est aux parlementaires de comprendre que la situation est nouvelle. Ils doivent devenir responsables. Ils ne pourront pas se contenter de faire de l’anti-Macron durant tout leur mandat. Ils vont représenter une force politique aux côtés d’autres. Ils devront donc avoir le courage de faire des propositions », estime Gaspard Koenig. « L’essentiel, reprend le philosophe, est qu’on trouve en France un éthos de la discussion, du débat et du compromis, qui nous manque cruellement. La Ve République a organisé un système beaucoup trop binaire, avec une majorité d’un côté et une opposition de l’autre. Cette nouvelle situation est désirée par les électeurs. Elle oblige le politique à retrouver l’essence même du débat et de la démocratie. C’est moins romantique, sans doute, mais ce sera plus productif, plus sain pour la société. À condition que tout le monde joue le jeu, bien sûr ».
Cristallisation des débats autour d’Israel et du boycott
Or, dès les premières sessions parlementaires, l’esprit de dialogue a volé en éclats. Et s’il était logiquement question de solutionner l’inquiétude populaire autour de la hausse des prix et de la baisse du pouvoir d’achat, il n’aura pas fallu longtemps pour que des députés communistes et insoumis, rangés derrière la bannière NUPES, profitent de cette session parlementaire estivale pour émettre une résolution condamnant Israel comme un régime d’apartheid. Contre toute attente, ce sont ainsi 36 députés dont quelques figures emblématiques de la NUPES qui ont signé la proposition de résolution nº 143[1] condamnant « l’institutionnalisation par Israël d’un régime d’apartheid à l’encontre du peuple palestinien ». Parmi ceux-ci, on trouve le candidat communiste à la présidentielle 2022 Fabien Roussel, les Insoumis David Guiraud et Bénédicte Taurine, l’ex marcheur sécessionniste Aurélien Taché et deux figures emblématiques qui ont plus tard retiré leur signature en catimini : Mathilde Panot et Adrien Quatennens, respectivement présidente du groupe LFI à l’Assemblée nationale et successeur annoncé de Jean-Luc Mélenchon.
Inattendu en ce qu’il était alors déconnecté d’une quelconque actualité, le texte se révèle à la lecture d’une virulence rare. Il débute par cette citation attribuée à Nelson Mandela, « Notre liberté est incomplète sans celle des Palestiniens » et fait d’emblée le lien entre apartheid en Afrique du Sud et apartheid en Israël, comme si les situations se valaient l’une l’autre, dans un parallélisme simplificateur. L’énoncé s’articule en plusieurs temps : Israël aurait tout d’abord « institutionnalisé un régime d’oppression et de discrimination systématique appliqué à l’ensemble de la population palestinienne ». L’Etat d’Israël exprimerait ensuite « une intention claire de maintenir le régime d’apartheid ». Il aurait de plus « perpétré plusieurs actes inhumains énumérés par la Convention sur le crime d’apartheid à l’encontre du peuple palestinien ». A cela, la proposition émanant d’une partie de la gauche radicale ajoute deux points centraux : la reconnaissance de l’Etat palestinien d’une part, aspect pourtant déjà largement validé par l’opinion publique française ainsi que la diplomatie tricolore. Plus étonnant, plus militant aussi, la « reconnaissance de la légalité de l’appel au boycott des produits israéliens ». Autrement dit, un appui sans équivoque au mouvement BDS.
Ce dernier point, à n’en pas douter, ancre le texte dans une véritable radicalité portée en étendard, fonctionnant tel un marqueur rougissant une gauche accusée de perdre son enracinement et ses couleurs. « Ce qui importe », écrit justement Bruno Karsenti dans une analyse intitulée Alerte incendie à l’Assemblée nationale : la NUPES, l’antisionisme et la critique d’Israël[2] publiée dans la Revue K, « c’est seulement que l’antisionisme se déclare, répondant ainsi à un besoin européen de gauche. Par où l’on voit que c’est bien lui, le capteur d’attention décisif, la confirmation qu’on recherche ». Karsenti poursuit : « L’enjeu décisif est que l’attention publique reste fermement focalisée sur Israël, bien plus rentable dans ses exactions supposées que ce que pourrait procurer une indignation encore à construire sur le sort de populations dont personne n’a cure, c’est-à-dire dont personne ne voit quel intérêt elles peuvent bien présenter pour entretenir l’indignation de nos dominés bien de chez nous, ceux auxquels on s’adresse prioritairement ici-même ».
Karsenti ne croit pas si bien dire. Au cours des derniers mois, les Insoumis se sont en effet illustrés par leur volonté d’épargner les régimes russes et chinois, de ne surtout pas les juger de peur de les heurter ni d’envenimer une situation jugée « explosive » sur le terrain. Ces mêmes précautions – d’aucuns parleraient volontiers de lâcheté ou de pusillanimité – ne semblent pas avoir cours lorsqu’il s’agit d’Israel, cible facile encore et toujours. Or, si le calcul de la gauche radicale revenant à diaboliser l’Etat d’Israël ne paie jamais vraiment électoralement (le Nouveau Parti Anticapitaliste s’y était jadis essayé sans succès), il n’est pas sans conséquences sur le destin des Juifs de France. Le schéma est bien connu et se répète sans cesse. En important le conflit israélo-palestinien dans l’hexagone, en lui offrant une actualité et une résonance politique, ce sont toujours les communautés juives qui paient le prix de la défiance, des accusations, des actes de violence. C’est ainsi qu’en croyant aider les Palestiniens, on menace bien davantage le Juif européen. Les députés de la majorité présidentielle, Aurore Bergé (Présidente du groupe Renaissance et du groupe d’amitié France-Israel à l’Assemblée) en tête, ne s’y trompent pas. Réagissant à la résolution 143, ils pointent du doigt « une obsession malsaine » dans laquelle « l’antisionisme le plus exacerbé le dispute à l’antisémitisme ». Les mots sont dits. Le combat, lui, ne fait que commencer.